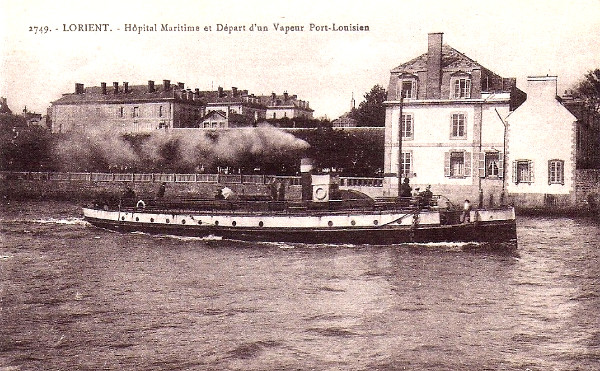|
|||||||
|
 |
|||||||||||||
Gérer l’accueil des réfugiés espagnols en Bretagne
La guerre d’Espagne est incontestablement l’un des plus grands drames du 20e siècle. Opposant les républicains aux nationalistes, le pays est ravagé par les bombardements dont le plus célèbre est celui de Guernica, immortalisé aux yeux du grand public par le tableau éponyme de Pablo Picasso. Fuyant les destructions, des milliers d’Espagnols décident de tout abandonner et trouvent refuge de l’autre côté des Pyrénées, en France.
L’histoire de cet exode est encore peu connue. Si le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale relègue l’histoire de ces Espagnols au second plan, le souvenir de la gestion catastrophique de cette arrivée de ces migrants par les autorités françaises explique également ce trou mémoriel. Il faut attendre près de 50 ans pour voir émerger les premières synthèses nationales grâce, notamment, aux travaux d’Emile Temine, de Geneviève Dreyfus-Armand, de Pierre Milza ou encore de Denis Peschanski. Localement, si les régions du sud de la France sont assez largement étudiées, ce n’est pas le cas de la Bretagne. Il faut dire qu’elle paraît peu concernée par ces évènements en raison de son éloignement géographique. Pourtant, à bien y regarder, près de 21 000 réfugiés auraient transité par la région entre 1937 et 1939. S’il existe bien quelques mémoires universitaires de qualité, il manquait néanmoins un ouvrage de synthèse. C’est ce que propose Isabelle Le Boulanger dans L’Exil espagnol en Bretagne (1937-1940), publié chez Coop Breizh1. Pour y parvenir, l’auteure a réalisé un minutieux travail de recherche en se concentrant sur la sous-série 4 M des Archives départementales, qui concerne les fonds de la police des étrangers. L’étude sérielle n’est pourtant pas simple tant il y a des « inégalités selon les départements », les Côtes-d’Armor conservant 35 liasses là où celles de Loire-Atlantique n’en possèdent que 12 (p. 17). En y ajoutant la presse et quelques témoignages de Bretons, l’auteure reconnaît avoir disposé d’une « masse archivistique foisonnante » et suffisante, ce qui lui a permis de laisser « de côté » les archives des collections municipales (p. 15). Mais, comme le regrette Isabelle Le Boulanger, les sources utilisées sont presque exclusivement bretonnes, offrant alors un point de vue exclusivement français et « très peu celui des Espagnols » (p. 19). Malgré ces contraintes, Isabelle Le Boulanger signe un formidable ouvrage qui non seulement pose les bases de l’exode espagnol en Bretagne mais invite les chercheurs à poursuivre les réflexions amorcées, notamment sur la gestion administrative de l’accueil des migrants. Ironie de l’histoire, l’ouvrage sort alors que l’Europe et la France s’efforcent de gérer l’accueil des réfugiés syriens, fuyant eux-mêmes la guerre civile. L’arrivée des Espagnols En 1937, la France est confrontée à une première vague d’immigration espagnole. N’ayant pas véritablement anticipé l’arrivée massive de ces milliers d’hommes et de femmes, elle est contrainte de prendre des « mesures d’urgence ». Dans un premier temps, l’Etat définit une zone de « 1e urgence », soit 31 départements dont la Loire-Inférieure. De leurs côtés, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère sont classés dans un second groupe prioritaire. Seules les Côtes-du-Nord manquent à l’appel. Mais, face à l’ampleur du flux, la préfecture à Saint-Brieuc est rapidement mise à contribution (p. 32). Tous les départements bretons sont donc concernés par l’arrivée des Espagnols dès le printemps 1937. Le placement des réfugiés aussi loin de la frontière répond à une exigence sécuritaire. Comme l’explique l’auteure, « une concentration d’Espagnols à la frontière risque d’entraîner des incidents, et le gouvernement souhaite à tout prix éviter que la guerre civile ne s’étende sur le territoire français » (p. 32).
Dans les faits, ce sont principalement les réfugiés basques et asturiens qui arrivent dans l’Ouest de la France. Dans l’incapacité de fuir par voie terrestre, ils sont évacués par la mer et gagnent de ce fait les ports de l’Atlantique (La Rochelle, Saint-Nazaire et Nantes). La plupart du temps, ces convois humanitaires sont escortés préventivement par des navires militaires français. Puis, suite à leur débarquement, les réfugiés sont répartis dans les différents départements français. Le cas du paquebot Habana, qui arrive à La Rochelle le 6 mai 1937 en provenance de Bilbao, montre parfaitement les mécanismes de la prise en charge des migrants (p. 33-35). Les 2 000 enfants et 483 adultes sont immédiatement auscultés par des médecins-militaires, soignés par du personnel de la Croix rouge et identifiés par les gendarmes. Après quelques heures, ils sont acheminés par train vers des centres d’accueil, dans le cas présent à Vannes, Pontivy, Port-Louis, Quimper et Telgruc-sur-Mer. De manière générale, seuls les femmes, les enfants et les vieillards sont hébergés dans les centres au nord de la Loire. De leurs côtés, les hommes en âge de combattre, considérés comme des « miliciens », sont prioritairement placés dans les camps du sud de la France, quand ils ne sont pas tout simplement renvoyés dans leur pays. De fait, cette répartition stratégique s’opère au détriment de toute logique de regroupement familial (p. 302). Les centres d’hébergement En Bretagne, les réfugiés sont donc placés dans des centres d’hébergement ouverts dans l’urgence. Le cas du Morbihan est significatif (p. 115). En 1937, les six centres sont établis dans deux hôpitaux désaffectés (Port-Louis et Vannes), dans une ancienne prison (Pontivy), dans une conserverie désaffectée (Ploemeur) et dans ancienne caserne (La Palais, qui devient par ailleurs le plus grand centre de Bretagne en 1939, p. 138). Seule une colonie de vacances à Quiberon offre des infrastructures non vétustes. Le préfet reconnaît bien volonté que celui de Port-Louis est « un peu délabré et démuni de moyens d’éclairage et de chauffage » (p. 136). Mais ce qui prévaut, c’est d’éviter une catastrophe humanitaire, et l’on s’accommode de ces sites qui font, pour l’instant, l’affaire. Les autres départements bretons ne proposent pas un meilleur bilan. En septembre 1937, Louis Guilloux obtient l’autorisation de visiter celui de Saint-Brieuc, installé dans un vieil hangar désaffecté. Il en ressort profondément bouleversé (p. 118) et écrit : « L’horreur du spectacle dépasse toute écriture. Ici, vraiment on ajoute au malheur […] Tout est misérable, sale, froid. Les murs qui sont faits de planches disjointes, sont couverts de toiles d’araignées. Par endroits, on ne voit plus les planches. Les réfugiés se plaignent que les araignées leur courent sur la figure pendant la nuit. Non seulement les araignées, aussi les rats. Impossible de nettoyer. Il faudrait un matériel dont les réfugiés ne disposent pas et, d’abord, des échelles. » Alertés sur ces conditions, les préfets profitent de nombreux départs, en 1937, pour fermer les centres les plus délabrés. Pourtant, de nouveau impuissants face à une nouvelle vague de réfugiés en 1939, ils doivent bientôt les rouvrir. Rien n’a été prévu entre-temps.
Cette impuissance est rapidement admise par les autorités locales. Conscientes qu’elles manquent cruellement de moyens, elles sollicitent la bienveillance de la population. Cette attitude est d’ailleurs très paradoxale. Si les autorités en appellent aux particuliers, c’est uniquement pour accueillir le surplus de réfugiés et subvenir à leurs besoins. Jamais une politique de désengagement étatique n’est envisagée. Dans la mesure du possible, les autorités préfèrent concentrer les réfugiés dans des centres de façon à pouvoir les surveiller. Alors que la France rencontre elle-même de vives tensions politiques, elle craint en effet que la propagande politique des « rouges » ne se propage dans les campagnes. Cette crainte semble d’autant plus compréhensible que les élections législatives de 1936 révèlent une progression sensible du vote socialiste, même dans les départements les plus conservateurs, et parfois dans les campagnes3. C’est pourquoi, la concentration des réfugiés offre de multiples avantages : elle permet de surveiller la correspondance (p. 223) et les opinions, le personnel agissant alors comme « les yeux et les oreilles du commissaire de police » (p. 204). Entre gestion improvisée et système D L’arrivée de ces Espagnols met en évidence les errances de l’administration française. Cette dernière souffre du manque de considération du gouvernement. Jamais elle ne reçoit une véritable ligne de conduite qui permettrait de mener une politique d’accueil sur le long terme – ce qui s’explique certainement par la conviction que les réfugiés rentreront rapidement chez eux (p. 253). Si de nombreuses circulaires émanent du ministère de l’Intérieur, elles se contentent en réalité de fixer « l’objectif final à atteindre » (p. 155). Et comme si ce n’était pas suffisant, viennent s’ajouter les rivalités entres ministères (p. 256). Sur le terrain, les préfectures sont débordées. Elles manquent de moyens humains et financiers. Dans ces conditions, l’administration égare régulièrement les bagages dans les gares (p. 92), et les agents multiplient les erreurs, notamment sur le dénombrement des réfugiés (p. 75). Ces ratés ont des conséquences fâcheuses comme lorsqu’en février 1939, 280 personnes arrivent à Saint-Lô au lieu des 210 annoncés (p. 76). Le centre est saturé et le personnel doit lui-même agir dans l’urgence pour trouver de quoi loger et nourrir ces 70 réfugiés. D’une certaine manière, les préfets tirent profit de leur autonomie pour agir pragmatiquement, ce qui leur permet d’optimiser l’accueil et l’hébergement des Espagnols dans leurs départements (p. 65). Cette souplesse permet d’agir rapidement lorsque des réfugiés arrivent de manière impromptue dans les petits ports bretons, à bord d’embarcations de fortune.
Les préfets doivent également improviser pour contourner les budgets « serrés » qui leur sont alloués par le ministère. Ils sollicitent par exemple l’autorité militaire pour obtenir des couchages décents (p. 158-162), « des cuisines roulantes et du matériel du cuisson » (p. 166). Mais ils se reposent surtout sur l’aide des particuliers et des associations. La population apporte en effet un véritable soutien logistique. Les motivations sont diverses : humanitaires, religieuses, et – majoritairement – militantes. La CGT multiplie ainsi les appels aux dons (p. 393), tout comme peut le faire plus localement des comités antifascistes (p. 389). Certaines motivations, plus difficilement indentifiables, sont personnelles. C’est le cas de Joseph Piolot, secrétaire de mairie à Plougonver, qui déclare être redevable envers l’Espagne qui a œuvré, pendant la Grande Guerre, à son rapatriement sanitaire vers la Suisse alors qu’il était prisonnier en Allemagne (p. 123). Les logiques de solidarité sont donc multiples et, même si elles ne concernent qu’une minorité de la population (p. 451), elles apportent une aide inestimable à l’administration. A juste titre, Isabelle Le Boulanger se demande si l’administration ne se repose pas essentiellement sur cette « charité » de circonstance pour pallier son impuissance. En effet, les réseaux officiels s’essoufflent rapidement, les commerçants montrant leur lassitude face aux retards permanents de leur indemnisation (p. 161). De ce fait, l’auteure précise que (p. 291): « Véritable pierre d’achoppement de la politique d’accueil, la question budgétaire ne trouve, pour seule solution, que la charité publique appelée à pallier les besoins les plus élémentaires à défaut des sommes allouées suffisantes. Jamais le gouvernement ne semble envisager que le mouvement charitable puisse s’épuiser. » Terre d’exil ou terre d’accueil ? Dans ces conditions, si la France s’improvise comme une terre d'exil pendant près de trois ans, jamais elle ne devient une véritable terre d'accueil. Bien au contraire, dès qu’elle le peut, l’administration incite les migrants espagnols à « réémigrer » dans les pays hispanophones, comme le Mexique. Globalement, ceux qui tentent l’aventure sont peu nombreux, seulement 32 en Ille-et-Vilaine en 1939 (p. 323). De son côté, la population se montre également peu réceptive au sort des réfugiés. En 1937, seules 18 communes morbihannais accueillent des réfugiés, soit à peine quelques dizaines de familles (p. 116). La solidarité ne résiste pas non plus aux intérêts particuliers. Si la SNCF met à disposition la colonie de vacances de Quiberon en février 1939, elle exige cependant que les locaux soient évacués avant le 1er avril de façon à ce qu’ils puissent être remis en état avant pour l’arrivée estivale des enfants du personnel (p. 137). De manière plus ferme, le député parisien René Dommange s’oppose à ce que la colonie de vacances appartenant à la Caisse des écoles du 7e arrondissement de Paris, puisse accueillir des réfugiés, comme le souhaitait le préfet du Morbihan. Son explication est simple : « on ne connaît pas la durée de l’occupation et leur évacuation nécessiterait des frais de désinfection » (p. 137). En 1939, alors que la guerre menace l’Europe, la question de la présence des réfugiés devient encore plus sensible (p. 337). L’administration ne souhaite plus s’encombrer de cette gestion encombrante. Elle accélère les retours avant de faire machine arrière. Avec la mobilisation, les autorités comprennent qu’elles ont désormais besoin de la main-d’œuvre espagnole. Rien que sur Rennes, plusieurs dizaines d’ouvriers sont alors recrutés pour les besoins de la nation (p. 288).
En définitive, l’ouvrage d’Isabelle Le Boulanger suscite une double réflexion sur l’exode espagnol en Bretagne : humaine et administrative. En s’intéressant à un sujet encore méconnu de l’histoire de l’entre-deux-guerres, l’auteure livre un travail exemplaire et amené à faire date. Il y a toutefois une interprétation sur laquelle nous souhaitons revenir. Isabelle Le Boulanger précise à de nombreuses reprises que, « jamais au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Bretagne ne vit affluer tant de femmes, d’enfants, de vieillards, ‘d’inaptes’ et de malades, la plupart dans le dénuement le plus total » (p. 63). C’est, nous semble-t-il, oublier les vagues de réfugiés qui arrivent en Bretagne lors de la Grande Guerre4. Entre 1914 et 1918, le Morbihan accueille à lui seul entre 20 000 et 30 000 réfugiés, dont de nombreux Belges5. C’est sensiblement le même chiffre (21 000) qu’avance Isabelle Le Boulanger pour l’ensemble des cinq départements bretons entre 1937 et 1940 (p. 454). Cette précision nous semble d’autant plus importante qu’elle témoigne de l’expérience de l’administration face à une situation similaire vécue deux décennies auparavant. Comparable d’ailleurs en de nombreux points puisque, là aussi, les services administratifs sont dépourvus face à l’ampleur d’un flux migratoire qui dépasse les prévisions : là-aussi ils doivent faire face aux budgets restreints qui leur sont alloués ; là-aussi ils doivent agir pragmatiquement pour tenter d’assurer correctement l’accueil de tous les réfugiés6. Or n’est-ce finalement pas cette expérience du précédent conflit qui permet à l’administration locale de gérer tant bien que mal la situation entre 1937 et 1939, en dépit de l’inaction politique du gouvernement ? Yves-Marie EVANNO
LE BOULANGER, Isabelle, L’exil espagnol en Bretagne (1937-1940), Spézet, Coop Breizh, 2016.
1 LE BOULANGER, Isabelle, L’exil espagnol en Bretagne (1937-1940), Spézet, Coop Breizh, 2016. Afin de ne pas surcharger inutilement l’appareil critique, les références à cet ouvrage seront dorénavant indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses. 2 GUILLOUX, Louis, Carnets, 1921-1944, Paris, Gallimard, 1978, p. 168-171, cité par l’auteure p. 118. 3 Sur ce point, on peut évoquer par exemple le cas du Morbihan, EVANNO, Yves-Marie, « Le Morbihan contre le Front populaire ? », in LE GALL, Erwan et PRIGENT, François (dir.), C'était 1936. Le Front populaire vu de Bretagne, Rennes, Editions Goater, 2016, p. 78-101. 4 Pour une synthèse récente, se rapporter notamment à POPELIER, Jean-Pierre, Le premier exode. La Grande Guerre des réfugiés belges en France, Paris, Vendémiaire, 2014. 5 Si les autorités départementales annoncent pour l’ensemble du conflit un total légèrement supérieur à 20 000 réfugiés, de son côté, Émile Gabory, citant M. Lamourec, chef de division à la préfecture du Morbihan, indique un effectif de plus de 30 000. Arch. dép. du Morbihan, 4 M 568, nombre total des réfugiés de toutes nationalités, 1er septembre 1918 et GABORY, Emile, Les réfugiés chez nous, Paris, Berger-Levrault, 1921, p. 227. 6 Sur ce point, et pour continuer sur l’exemple morbihannais, voir par exemple « Un département refuge », in Coll., Les Morbihannais dans la guerre 14-18, Vannes, Archives départementales du Morbihan, 2014, p. 68-75. |
|||||||||||||
 |
 |
 |
 |
 |