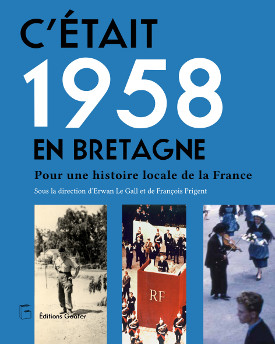|
|||||||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezañ ugent vloaz en e bennti. Avoir vingt ans à la ferme. Saisir la jeunesse bretonne de 1958 n’est pas chose évidente. C’est pourtant à cette difficile tâche que s’attaque Jean-Christophe Billoit à l’aide de témoignages inédits permettant d’esquisser non seulement le portrait d’une génération mais de souligner combien les campagnes de la péninsule armoricaine constituent un monde à part, à 1 000 lieues de ce qui peut se vivre dans les grandes villes et notamment à Paris. Par Jean-Christophe BRILLOIT
En 1951, les photographes de la toute nouvelle agence de presse Magnum se lancent dans un vaste reportage international, Génération X. Leur but : dresser le portrait de cette génération qui vient d’avoir vingt ans, dans quatorze pays différents. Leur enquête est publiée en 1954 dans divers magazines à travers le monde. En France, Point de vue, Images du monde, publie ces reportages. Les lecteurs y découvrent entre autres, Colette, une jeune parisienne. En revanche, aucun jeune breton n’a été sélectionné par le journal1. Une décennie plus tard, une toute autre enquête est lancée, sous l'égide de la Délégation à la Recherche scientifique et technique. Une équipe pluridisciplinaire investit la petite commune bretonne de Plozévet, dans le Finistère. A cette occasion Edgar Morin prend en charge une enquête de « sociologie du présent » dont il tire un brillant essai publié en 19672. Fin observateur de la jeunesse3, pour laquelle il invente le terme de yéyé qui définit « la culture qui les nourrit », il dresse le portrait des jeunes de Plozévet au milieu des années 19604.
Ce n'est pas seulement une décennie qui sépare ces deux portraits, ni une différence de méthode mais un gouffre social. Il n'y a en effet pas grand-chose de commun entre Colette qui fréquente les haras et les champs de courses parisiens, et « les trois fleurs de la lande »5 de Plozévet. Entre les jeunesses du monde et les jeunes de Plozévet6, il n’y a pas que quelques lettres d’écart, mais des réalités et des concepts ambigus qui imposent quelques précisions. En 1984, le sociologue Pierre Bourdieu prévient : « La jeunesse n’est qu’un mot »7. En 1987, l’historienne Ludivine Bantigny, dans un ouvrage de référence8, reprend sous une forme interrogative cette formule provocatrice : « La jeunesse n'est- elle qu’un mot ? » et fournit une bonne mise au point sur les contenus et usages des concepts de jeune et jeunesse9. Les lignes qui suivent n’ont pas l’ambition de dresser le portrait de la jeunesse bretonne ou d’une génération, mais plus modestement de rester au plus près de ce qui est le quotidien, non de la jeunesse mais de quelques jeunes, anonymes, qui ont eu l’amabilité et le courage de fouiller dans leur mémoire pour en extraire ce qui a constitué leur jeunesse et la matière première de cette contribution. Je tiens, ici, à les en remercier chaleureusement, j’espère qu’ils se reconnaîtront et que je n’ai pas trahi leurs propos. Pour des raisons évidentes de respect, j’ai préféré anonymiser les entretiens, chaque interlocuteur est simplement désigné par une initiale. Forcément et fortement inscrites dans des lieux et des mémoires spécifiques, ces expériences individuelles ne peuvent être généralisées, à tous les jeunes de Bretagne ou d’ailleurs. Cependant elles n’en demeurent pas moins exemplaires.
Retour sur les sources mobilisées « Mon seul dessein dans tout cet ouvrage est de consigner ce que j’ai pu entendre dire aux uns et autres »10, « tant au sujet des faits dont j’ai moi-même été un témoin que pour ceux qui m’ont été rapportés par autrui, j’ai procédé chaque fois à des vérifications aussi scrupuleuses que possible »11. C’est en ces termes qu’Hérodote et Thucydide, considérés comme les pères fondateurs de la science historique, exposent leur méthode de collecte des informations. Tout est dit, ou presque, sur la méthode utilisée pour réaliser cette étude sur les jeunes en Bretagne en 1958. L’un comme l’autre ont eu recours aux témoignages oraux de leurs contemporains. Malgré cette paternité revendiquée, la science historique, depuis qu’elle s’est constituée comme telle avec ses méthodes spécifiques au 19e siècle, a eu quasiment exclusivement recours au document écrit. Alors que les sociologues utilisent largement les enquêtes orales, les historiens sont longtemps restés frileux, pour ne pas dire hostiles, à l’égard de ces sources. Histoire et archives orales sont même vivement dénoncées par Jean-Jacques Becker12, en 1986, dans une mise au point méthodologique très argumentée, qui finalement rejette catégoriquement son utilisation. Il y a toutefois fort à parier que le vénérable historien ne défendrait pas, aujourd’hui, quelques 30 années plus tard, la même position. L’usage et l’exploitation de témoignages oraux est aujourd’hui réhabilité, pour ne pas dire parfaitement légitime et, du reste, assez courant. Il faut souligner là le rôle pionnier de Philippe Joutard13 et de certains terrains historiographiques dont les caractéristiques obligent à d’autres méthodes. C’est ainsi par exemple qu’en Amérique latine, les témoignages sont un moyen de contourner le biais des archives écrites officielles, produites dans le cadre des dictatures militaires. Ajoutons d’ailleurs que ce mouvement de diversification des sources concerne également la photographie, archive dont l’exploitation est certes contraignante mais qui apporte beaucoup à l’extension des connaissances14.
Néanmoins, proposer une étude qui repose quasiment exclusivement sur des sources orales peut se révéler périlleux sans une petite mise au point méthodologique qui doit beaucoup aux travaux de Françoise Descamps15. Si la prudence est toujours de mise pour tout ce qui concerne l’histoire de « la jeunesse »16, l’historien bénéficie désormais « d’un héritage historiographique déjà riche »17 inventorié par Ludivine Bantigny, et qui permet de baliser l’exploration de cette classe d’âge. Mais, pour la période qui nous occupe ici (à savoir 1958 et la fin des années 50), les études les plus importantes concernent un espace géographique large, en l’occurrence la France18. Les jeunes observés à l’échelle locale sont beaucoup plus insaisissables et n’ont pas motivé les historiens. Il est vrai qu’une approche locale pose le problème des sources utilisables car les jeunes, surtout dans les catégories populaires, n’ont guère l’occasion de prendre la parole. Anne-Marie Sohn19 a su retrouver cette parole juvénile par l'intermédiaire des lettres envoyées à Ménie Grégoire, animatrice vedette de RTL, mais cette correspondance ne débute qu'en 1967, donc bien après la période qui nous intéresse. De même, Alain Vergnioux et Jean-Marc Lemonnier20 abordent la jeunesse à travers leur journal emblématique Salut les Copains, mais celui-ci n'est publié qu'à partir de 1962. L'étude la plus vaste et la plus minutieuse reste donc celle de Ludivine Bantigny21. Dans la masse documentaire rassemblée et étudiée par l'historienne, la parole des jeunes n'est pourtant pas la plus présente. Parmi la trentaine d'entretiens qu'elle a enregistrés dans les années 2000, figurent des jeunes gens qui avaient une vingtaine d'années dans les années 1950, mais la plupart étaient élèves de l’Ecole normale supérieure à Paris, donc socialement et culturellement aux antipodes des jeunes dont je souhaitais partir à la recherche. Néanmoins, l'idée de recueillir directement leur parole m'a paru d'autant plus stimulante que « les traces laissées à son propos [la jeunesse] étaient extérieures, provenant, par exemple de la puissance publique ou de la sphère d'élaboration du savoir »22. De plus, une première base documentaire, celle assemblée à l'occasion de la grande enquête menée à Plozévet est disponible. Les archives d’Edgar Morin sont en effet déposées à l'IMEC23 et des centaines d'entretiens réalisés en 1965 sont numérisés et conservés par la médiathèque Dastum24. Or Jean-François Sirinelli invite « à considérer les enquêtes sociologiques comme une source majeure pour l'analyse historique des jeunes »25. Toutefois, l'exploitation de ces archives m'a semblé se heurter à plusieurs obstacles. D'abord, chronologiquement, l'enquête n’est lancée qu’en 1963 et les entretiens réalisés en 1965, donc un peu tardivement par rapport à la date de référence de 1958. Cette dimension est d’autant plus importante que les changements ont pu être rapides, et risquaient donc de devenir invisibles. En outre, ce matériau a été brillamment exploité par Edgar Morin dans son livre de référence26 et le risque était de ne fournir qu'une plate répétition sans intérêt. Enfin, le cadre très étroit d'une commune ne fournissait qu'une image très restreinte des jeunes bretons. J'ai donc préféré m'écarter un peu, mais pas totalement, de ce chemin pour en explorer d'autres. Pour accéder directement à la parole des jeunes, « anonymes de la grande histoire »27 jamais interrogés ni sollicités puisqu'ils n'occupent pas les positions de pouvoir qui ont le plus souvent la faveur des historiens, j'ai pris le parti de créer des archives orales susceptibles de compléter les archives écrites plus conventionnelles. A cet effet, le plus efficace reste de s'appuyer sur les méthodes d'enquêtes largement utilisées et mises au point par les sociologues28. L'objectif est de recueillir un nombre limité de témoignages et de les exploiter à différentes échelles. C'est à dire confronter ces mémoires vivantes de jeunesses individuelles, inscrites dans une réalité sociale bien précise, aux résultats obtenus à l'échelle nationale29 et à l'échelle très locale du Plozévet du milieu des années 196030. De la sorte, la démarche adoptée reste strictement qualitative. Ni le nombre, ni le contenu des entretiens ne peuvent donner lieu à une exploitation quantitative ou statistique31. Ces témoignages ne doivent donc pas être considérés comme représentatifs d'une génération. Ils ne peuvent pas être généralisés aux jeunes ou à la jeunesse de 1958, pas plus que le meunier Ménocchio32 ne l'est de la société du Frioul de la Renaissance ou le sabotier Louis François Pinagot33 de la société française du XIXe siècle. Pour autant, si la montée en généralité ne doit pas être automatique et requière prudence, il n’en demeure pas moins que recourir au particulier n’a de sens que lorsque confronté au général. C’est ainsi, par exemple, qu’un simple poilu de Quessoy, dans les Côtes-du-Nord, permet de dresser, par le biais de la méthode indiciaire, le portrait de cette génération de Bretons qui, en août 1914, entre en Première Guerre mondiale34. Aussi, dans le cadre de la présente enquête, c’est sans doute moins la représentativité du corpus, au demeurant impossible à établir finement, que sa cohérence qui importe. Pour constituer ces archives, il fallait d'abord constituer un corpus significatif. J'ai donc fait appel à mes étudiants (hypokhâgnes au lycée de Quimper) afin qu'ils sollicitent leur entourage, parents, amis, voisins, connaissances dont la seule caractéristique était d'avoir eu une vingtaine d'années en 1958. Je tiens à les remercier de s'être acquitté de bonne grâce de cette tâche, au point d'avoir collecté un nombre conséquent et finalement trop important de contacts. J'ai donc dû opérer une sélection, à la fois pour des raisons d'efficacité et aussi parce que « toute personne sociale n'est pas interviewable »35. Le premier critère de sélection aura été géographique, à savoir des jeunes issus des quatre départements bretons, mais aussi localisés dans des communes suffisamment proches pour effectuer comparaisons et recoupements, comme par exemple, Bubry et Saint-Caradec-Trégomel (dans le Morbihan), ou Châtelaudren et Pédernec (dans les côtes d'Armor) distants d'une vingtaine de kilomètres. De même, j'ai pu trouver des jeunes de Plozevet et de la commune voisine de Pouldreuzic pour effectuer des comparaisons avec l'enquête de 196536. D'autre part, ne cherchant pas à dresser un portrait représentatif de toute la jeunesse bretonne, j'ai préféré me cantonner à un groupe socialement homogène, des jeunes issus des campagnes, dont les parents étaient pour la plupart paysans, ce qui correspond aussi à la réalité sociale de la Bretagne de la fin des années 1950, encore largement rurale comme le prouvent les données historiques à disposition. Enfin, sans chercher à tout prix la stricte parité, je me suis efforcé de donner la parole aux jeunes des deux sexes.
Une fois le groupe constitué, j'ai établi les premiers contacts téléphoniques. La plupart a accepté de bonne grâce une rencontre et un entretien. Les refus, au final, n’ont pas été nombreux. En revanche, il a parfois fallu vaincre certaines réticences, habituelles dans ce genre de démarche37 : « oh mais non, vous savez je n'ai rien d'intéressant à dire » ou « Oh là là c'est si loin. Je ne vais pas me souvenir ». Dès l'accord obtenu, je me suis efforcé de réaliser l'entretien le plus rapidement possible, en général au cours de la semaine qui suivait, afin d'éviter d'éventuels processus de reconstruction38. Le plus souvent, les entretiens ont été réalisés sur place, au domicile des témoins qui m'ont accueilli chaleureusement, et m'ont accordé généreusement leur temps. L'entretien a duré en moyenne entre une et deux heures. Même si j'avais établi une trame générale autour de quelques thèmes fondamentaux définis à partir des travaux déjà réalisés sur la jeunesse en France, je ne présente pas de grille toute faite avec un questionnaire préétabli. Je tenais à conserver la plus grande spontanéité et à éviter de figer la parole dans un cadre trop strict. L'entretien prend donc la forme d'une discussion très libre, sans ordre prédéfini, avec digressions et anecdotes39. Je me contente de prendre quelques notes pour éventuellement revenir sur un point ou un autre à préciser. Intervenant le moins possible, je laisse mon interlocuteur raconter en toute liberté. Évidemment, les entretiens sont forcément hétérogènes du fait des inégales capacités de remémoration, ou d'une certaine timidité, surtout chez celles et ceux qui avaient manifesté des réserves initiales. Mais les historiens savent bien que les archives écrites ne sont pas les plus homogènes40. Enfin, les témoignages et archives orales ne peuvent être exploités sans précautions ni critiques. Comme pour tout document autobiographique la position du témoin peut amener d'importantes déformations de la mémoire, plus ou moins volontaires. Elles peuvent aller jusqu'à une reconstruction du récit qui perd alors une bonne part de sa fiabilité41. Dans le cas présent, les témoins appartiennent à la catégorie des « petits » ou « moyens » définis par Françoise Descamps42, c'est-à-dire des jeunes, anonymes, qui n'ont pas à revendiquer ou assumer un quelconque rôle historique. Ils ne se préoccupent donc pas de l'image à laisser à la postérité et ne sont pas « écrasés par les enjeux de mémoire collective ou d'image publique »43. D'autre part, l'objet d'étude, la vie quotidienne, n'est pas un objet historique suffisamment problématique pour entraîner et justifier une puissante reconstruction rétrospective44. De plus, les consignes données pour l'entretien invitaient expressément les témoins à évoquer ce qu'ils ont vu et vécu personnellement, et non pas à livrer une réflexion ou une analyse sur les années 1958. Néanmoins, en fonction de leur culture et de leurs engagements, peuvent surgir des « interférences livresques »45 qui modifient sensiblement la perception du passé. Ainsi, un des témoins, très attaché à la culture bretonne et fin connaisseur de l'œuvre de Pierre-Jakez Hélias et de la polémique46 avec Edgar Morin à propos de l'enquête de Plozevet, a largement insisté, à plusieurs reprises, sur les brimades et punitions liées à l'usage du breton à l'école, sans que ce fait soit aussi marquant pour d'autres témoins qui vivaient pourtant au même endroit. Par ailleurs, le choix délibéré de prendre des témoins qui ont vécu leurs jeunes années dans des régions proches permet de croiser et confronter les témoignages entre eux afin de repérer contradictions ou convergences47, et donc de mieux apprécier la fiabilité des propos. Croiser les sources, c'est la démarche de tout historien, et elle n'est en rien spécifique aux archives orales. Ainsi, les descriptions, concordantes des témoins sur les fermes de leurs parents, correspondent en tous points aux observations d’André Burguière48.
Toutefois, la principale faiblesse de ces archives, constituées a posteriori, reste la difficulté à inscrire les informations recueillies dans une trame chronologique fiable49. Rares sont les témoins dont la mémoire permet de retrouver une date précise. Le plus souvent, elle est reconstituée par un enchaînement à partir d'une étape marquante de la vie de ces jeunes. L'école et les examens fournissent des bornes chronologiques prégnantes, au même titre que le mariage ou l'entrée dans le monde du travail. Mais, même s'ils ne sont pas d'une précision absolue, ces témoignages s’inscrivent dans des temporalités suffisamment définies pour être exploitables.
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des personnes interviewées. Dès lors que l'on applique rigoureusement quelques règles indispensables à la constitution d'archives orales et qu'on les exploite avec méthode, pourquoi se priver de la parole de ces jeunes Bretons? Pourquoi ne pas les écouter parler de leurs vingt ans en 1958? Certes, la démarche mise en œuvre ne vise pas l’exhaustivité car l’échantillon retenu ne compte qu’une dizaine de jeunes aux caractéristiques bien précises. A une exception près, ils sont tous issus du monde rural. Dans les années 1958, Re et AM vivent dans des communes rurales de la périphérie de Rennes et du pays de Redon. R et C passent leur jeunesse dans des villages enclavés de la campagne morbihannaise. R a bien insisté en préalable sur cet isolement : « pas de routes, seulement des chemins creux » pour accéder à la ferme familiale. M, D et Al viennent des campagnes bigoudènes, et plus précisément de Plozévet et des communes attenantes. MT vit ses jeunes années dans la commune littorale de Penmarc’h, à la pointe du pays bigouden. Enfin Y et An, en 1958 toujours, sont l’une dans la petite commune rurale de Pédernec, dans le Trégor, et l’autre dans la petite ville de Chatelaudren, dans le pays de Saint-Brieuc, qui compte alors un millier d’habitants. Tous sont issus de milieux modestes. Chez MT à Penmarc’h « y avait quatre vaches et un cheval. Rien, rien ». D fait à peu près le même constat « à la maison, il y avait rien », et M de la commune voisine est encore plus expressive à propos de ses parents « pauvres comme Crésus ». Autant de reflets d’un monde paysan, qui vit parfois difficilement sur des terres dont les exploitants ne sont pas toujours propriétaires. Les parents de R et C cultivent des champs dont ils sont locataires. Al et J viennent de ce monde paysan bien que les parents ne soient pas agriculteurs. Le père de Al est ouvrier à la conserverie Hénaff à Pouldreuzic, mais les grands-parents étaient paysans. De même le père de Re est chef cantonnier et sa mère travaille à la journée dans les fermes à l’entour. Enfin ce petit groupe de témoins appartient à cette même génération qui a entrevu la Seconde Guerre mondiale, conflit qui a parfois laissé des souvenirs prégnants. En 1958, ces témoins ont tous une vingtaine d’années. Le terme est pris dans son acceptation la plus large, entre 14 et 22 ans, pour garder les bornes de la « jeunesse » établies par Ludivine Bantigny50. A est la seule à avoir dépassé cette étape d'apprentissage car elle a 26 ans quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, et c’est la seule à être mariée. Néanmoins, son témoignage est incontournable, à la fois pour repérer des évolutions, ou des écarts, notamment vis-à-vis des plus jeunes, comme Y qui n'a que 14 ans la même année, et aussi parce que A est la seule à avoir un regard un peu « extérieur » puisqu'elle n'est pas originaire de Bretagne. Elle a quitté la région toulousaine et sa famille en 1949 pour l’École normale de Saint-Brieuc : « c'est presque le hasard » dit-elle, celui du concours d'entrée à l’École normale qui la conduit en Bretagne. Tous les autres jeunes ont entre 14 et 22 ans et vivent différemment leurs 20 ans. C, R, MT, Y et AM ont quitté les bancs de l'école et sont au travail. En revanche, Re, M, D et Al terminent leurs années de lycée à Rennes, Quimper et Pont-l’Abbé. En 1958, AM travaille déjà depuis deux ans à Paris, et c'est justement pour cette raison que j’ai conservé son témoignage. En effet ses propos relatent bien l'expérience de la montée à Paris, partagée par tant d'autres jeunes, mais aussi des retours épisodiques dans la ferme familiale, à l'occasion des vacances. Re et R ont aussi vécu cet exode (rural) qui n’est peut-être pas pour autant vécu comme un exil51. Depuis la ferme, l'atelier ou le lycée, citoyens majeurs ou en passe de l’être, femmes ou hommes, tous traversent cette année 1958 qui, du point de vue institutionnel clôt le chapitre ouvert en 1946 et en ouvre un autre, toujours en cours. Mais pour ces jeunes gens, les soubresauts de cette année ont-ils la force de l’événement qui façonne une vie et s'inscrit durablement dans la mémoire ? Leur regard est-il vraiment tourné vers Paris, Colombey ou Alger ? Les réalités du village ou du bourg, peut-être triviales vues « d'en haut », n'étaient-elles pas à leurs yeux autrement plus déterminantes et prégnantes ? Et surtout ont-ils le sentiment d'appartenir à un groupe social spécifique, « les jeunes », avec culture, valeurs et sociabilités propres, dont observateurs52, journalistes53 et historiens ont noté l'émergence, « la montée en puissance » à partir des années 1950 ? 54
Pour mieux cerner ce petit groupe et son éventuelle spécificité, il faut d'abord pousser la porte de la ferme familiale, pénétrer dans leur univers domestique et y déceler l' absence de ces objets modernes emblématiques de la culture jeune, puis les observer, en dehors du cercle familial, entre eux, entre « copains » lorsqu'ils se retrouvent et partagent les mêmes loisirs, caractéristiques de la culture juvénile, enfin appréhender leur rapport au monde, à travers les choix, propres à tous les gens de leur âge et qui identifient une génération: partir, rester, militer ou se battre en Algérie.
L’accès des jeunes à la société de consommation Alors même qu'à Paris Boris Vian chante discrètement La Complainte du Progrès, les jeunes villageois vivent dans un tout autre environnement, puisque la société de consommation n'a pas encore franchi la porte de la ferme. « y avait qu'une grande pièce » Mise à part A, tous vivent dans des fermes au confort plus que sommaire et à l'espace limité. Au mieux l'habitation compte deux pièces, et disposer d'un endroit personnel pour ces adolescents n'est même pas concevable. « Chez ma grand-mère » avec qui a toujours vécu Y « y avait qu'une pièce. (…) Moi je dormais sous les toits au-dessus, y avait pas de mansardes à l'époque. On voyait les ardoises. C’est comme dans un vulgaire grenier. » La réalité n’est guère différente ailleurs. A Bubry, même si la ferme « là où je suis né et j'habitais jusqu’à 18 ans [est] un beau bâtiment, pas un manoir mais limite », « tout était dans une seule grande pièce ». Re à Saint-Germain-sur-Ille est confronté à la même promiscuité « tous dans la même pièce », d'autant plus pénible à supporter que l’atmosphère familiale est pesante. Ailleurs, la maison dispose de deux pièces, comme à Penmarc’h, chez les parents de MT : « Deux grandes pièces et rien en haut, c’est là qu’on mettait le blé, une cuisine avec deux lits de côté, et la chambre avec plancher et deux lits de côté ». La disposition est la même à Saint-Caradec-Trégomel. C « dormait dans la cuisine » car la maison ne compte que deux pièces avec « un lit dans la cuisine et les parents dans la chambre ». Cet aménagement intérieur semble dominant dans les villages bretons, à la fin des années 50, voire au-delà puisque l'équipe qui investit Plozévet, quelques années plus tard, fait une description identique55. Quel que soit le village et sa proximité ou non d’une grande ville, le confort intérieur est le même et impose aux adolescents contraintes et rigueurs identiques. Les innovations présentées aux salons des arts ménagers, dont se moque B. Vian, ne risquent pas d’encombrer leur foyer.
Parmi les souvenirs les plus récurrents et les mieux gravés dans la mémoire, le froid et l'absence de chauffage arrivent en tête. Le cas le plus extrême est celui de R qui évoque sans nostalgie, « le chauffage, l’hiver [qui] se faisait par l'écurie qui était au bout. On avait une porte à double battant. On fermait la partie basse et la chaleur passait par la partie haute. » Partout la cheminée continue à occuper une place centrale, à la fois pour le chauffage et la cuisine. AM se souvient de sa mère « toute courbée » qui « faisait tout dans la cheminée ». A Pédernec, Y garde les mêmes souvenirs « on cuisait dans la cheminée, sur un trépied avec du bois en dessous », mais chez sa grand-mère un fourneau à bois permettait de gagner quelques degrés supplémentaires quand c’était vraiment indispensable. La grand-mère ne l'allumait que « l'hiver quand il faisait très froid » mais le laissait s’éteindre la nuit « A onze heures y avait que le fourneau qui était encore chaud ». Comme Y, plusieurs se souviennent « ça gelait le soir quand elle prenait de l’ eau… et voir de la glace dessus quand on se levait le matin ». Même An, qui vit dans une maison du bourg de Châtelaudren, se souvient des difficultés de chauffage, même si très vite elle investit dans « une bouteille de gaz et un radiateur » puis dans une « couverture électrique », confort moderne auquel les autres jeunes n'avaient pas accès. Pour R et Y, dans leur ferme, le confort c’est « notre couette de balle » : « Tous les ans c’était refait. On refaisait le matelas de balle et la couette de balle qu’on met par-dessus. En balle d'avoine plus légère » Et d’ajouter : « on n'avait pas froid avec ça ». L’avantage de cette literie est qu'elle ne coûte rien à la famille, car elle est produite par les enfants, dans le cadre domestique, au moment des battages. Y, qui en garde un souvenir très précis, confie : « Nous les gamines, on passait ça dans un espèce de filtre qu'on secouait pour faire tomber toutes les saletés. La balle qui était propre on récupérait dans des sacs. » « Pas de grande cuisine » Au quotidien, la même frugalité règne sur la table de ferme, même si les souvenirs sont plus ténus, car les jeunes ne partagent pas systématiquement le repas familial. AM ne se souvient que de « la galette de blé noir deux fois par semaine » à La Chapelle-Bouëxic, dans le pays de Redon. MT n'a pas de souvenir précis de ce qu'elle mangeait à la maison, mais le changement d’alimentation en arrivant à Quimper l'a marquée : « Qu’est-ce qu’on mangeait bien. Moi je connaissais pas les yaourts et les petits suisses quand je suis arrivée à Quimper. » Seule Y, qui vit avec sa grand-mère à Pédernec garde un souvenir très vif et sans nostalgie aucune de son quotidien : « Avec ma grand-mère il n’y avait pas de grande cuisine. La soupe au lait qu'est-ce que je détestais ça quand ma grand-mère faisait ça. C’était pas bon. Tous les soirs c’étaient les pommes de terre au lait ribot, avec de la caille (lait caillé). C'était le repas de tous les soirs dans les fermes. C’était ça tout le temps. » De là sa découverte du soufflé, en arrivant à Lannion, chez ses patrons qui la logent et la nourrissent : « la première fois que j'ai mangé un soufflé au fromage, c'était chez eux. Je me demandais ce que c'était. » « Quand on allume son feu on éteint sa lumière » Pour tous ces jeunes, les commodités de la vie moderne ne sont même pas un rêve, mais plutôt un continent inconnu. Y le résume bien : « Y avait pas. On connaissait pas et les autres non plus n'avaient pas. »
Le constat est unanime : pas d'eau courante dans les fermes. Tous décrivent la même réalité du seau à aller remplir au puits ou à la fontaine, et qu'on dispose dans la cuisine. R « allait chercher l’eau à la fontaine, à peu près à 70 mètres de la maison et ça grimpait. Deux seaux, le palonnier sur les épaules et les cercles autour des jambes pour pas se taper. » A est la seule à bénéficier « de l'eau sur l'évier », mais il est vrai qu'elle habite en ville. En revanche, tous se souviennent de l'électricité et parfois même de son arrivée, comme C à Saint-Caradec-Trégomel : « On a eu l'électricité, j'avais 17 ans », en 1957 donc ou R à Bubry, vers 1955. Ailleurs c'est plutôt au début des années 1950 qu'elle fait son arrivée, aussi les souvenirs sont moins précis. Néanmoins, disposer de l'électricité ne signifie pas disposer de l'équipement électro-ménager. Aucun ne se souvient avoir vu la moindre machine à laver ou réfrigérateur, chez eux ou chez des voisins. En 1958, quand R quitte la ferme, sa mère, qui fabriquait un beurre apprécié des crémiers lorientais, le conservait encore « l'été dans l’eau de la fontaine, dans un seau avec une assiette dessus ». De même à Saint-Germain-sur-Ille comme ailleurs, « le réfrigérateur c’est le cellier ». L'électricité ne sert donc qu'à l'éclairage et elle remplace avantageusement la lampe à pétrole ou les bougies que tous connaissent dans leur enfance, comme Y pour qui c'est encore le cas au milieu des années 1950 : « je faisais mes devoirs avec une bougie mise sur une assiette, ou sur une bouteille pour que la bougie éclaire loin. Ou bien alors c'était le petit lampion, le petit lampichon qu’on l’appelait, avec un peu de pétrole dedans. » Re lui se souvient parfaitement du « bouton marron » qu'il actionnait pour éclairer la cuisine. Mais cette commodité nouvelle n'en empêchait pas un usage parcimonieux, que la grand-mère de Y résume par une sentence sans appel : « quand on allume son feu, on éteint sa lumière », tant et si bien qu' « elle avait toujours plus d'abonnement que d'électricité », d’autant que l'éclairage se limitait « à une ampoule de 60 [watts] ». Son cas n'était sûrement pas exceptionnel car MT se souvient aussi que, chez elle, à Penmarc'h, « l'électricité coûte cher ». Pour ces jeunes, la modernité n'apparaît qu'au départ de la ferme, soit pour aller à Paris comme R, AM et Re, soit à l'occasion d'un travail en ville. Après avoir été embauchée à Lannion, Y prend conscience qu' « [elle] aura vécu bizarrement », que sa grand-mère « n'avait pas évolué » car « j'ai commencé à voir des choses oui ». En effet, elle est logée et nourrie par ses patrons, qui tiennent une boutique de peinture. Son univers est bien éloigné de celui de la ferme de Pédernec : « je mangeais comme eux, j'avais l'électricité, un lavabo dedans avec l'eau courante » et les employeurs « avaient de beaux meubles en merisier, toutes les commodités, ils avaient une salle de bains, ils avaient de belles carpettes, de belles choses, de beaux meubles ». « Elle ira manger là où elle donne son argent » Quand bien même ces jeunes veulent accéder aux nouveaux biens de consommation, ils doivent d'abord trouver l'argent. Or il est rare et doit se gagner. Si MT, R, C, Y ont tous un travail en 1958-59 et touchent un salaire, ils ne le gardent que rarement. C qui travaille l'été à la conserverie verse l'intégralité de son salaire à ses parents : « Le salaire, on le donnait aux parents. Eh oui. La totalité. Je gardais rien pour moi. » R quitte son village en 1958 pour travailler chez Citroën à Paris, mais bien qu'indépendant, « il se sentait obligé ». « Je lui rendais ce qu'elle m'avait donné. » Aussi il envoie par mandat à sa mère, qui n'avait pas de banque, tout ce qu'il peut économiser de son salaire : « j'arrivais à faire la moitié d'économies ». De même MT jusqu'à son mariage en 1960 « donne son salaire à la mère » car ma mère « avait la boite à gâteaux » et elle ne « se garde qu'un peu pour le bal et autre ». Il semble bien difficile de se soustraire à cette obligation. Lorsque le père de MT envisage de mettre l'argent de sa fille à la banque, elle se souvient parfaitement de la réponse cinglante de sa mère : « elle ira manger là où elle donne son argent ».
Si la pratique reste courante en 1958, elle n'est néanmoins pas systématique. AM et Re disposent de leur argent. Il est vrai que AM a quitté La Chapelle-Bouëxic pour Paris. Re part lui aussi travailler à Paris mais il a tout de même « reçu un peu d'argent à la mort du père ». Mais l'un comme l'autre ne semblent pas avoir envoyé leur salaire. Y qui travaille dès 14 ans « gardait l'intégralité. Ma grand-mère m'avait fait faire un livret de Caisse d’Épargne et m'obligeait quand même à faire des économies. » Elle pouvait donc disposer librement de son argent et garder ce qu'elle voulait « pour faire ce que t'as envie de faire », lui disait sa grand-mère, « les autres tu les mets sur ton livret », ce qui paraissait normal à sa grand-mère mais beaucoup moins à sa mère qui lui dit : « t'as de la chance qu'on te laisse ton salaire ». La grand-mère vient alors à la rescousse de sa petite-fille : « la grand-mère s'était un peu rebiffée sur elle, quand même, qu'elle dit, tu vas tout de même pas avoir le culot de lui prendre son salaire ». Les jeunes qui ne travaillent pas doivent gagner leur argent de poche et ne pas attendre ce que peuvent donner très ponctuellement les mères, comme C qui doit se contenter « d'un peu d'argent de poche donné discrètement par la mère ». Le plus débrouillard semble R qui a toute une technique pour avoir de « l'argent de poche sans problème » au point d'être « parfois plus riche qu'un ouvrier agricole ». « Les merles, les écureuils, les grives étaient vendus » et « Le crémier achetait ça dans la commune », parfois « complété de grillons pour les pêcheurs, les vipères aussi ». Il pouvait avoir « jusqu'à 40 merles dans le week-end », qu'il « portait en allant à l'école ». On comprend alors qu'il puisse avoir une « belle cagnotte », d'autant que « les parents n'y touchaient pas ». Plus modestement, Al donne un coup de main l'été dans les fermes de Pouldreuzic où il reçoit « un petit quelque chose ». Parfois l'été offre un véritable travail d'appoint. R et Al sont moniteurs de colonies de vacances vers 16, 17 ans, l'un à côté de Pouldreuzic, l'autre du côté de Paramé. Etant nourris et logés, ils amassent un petit pécule qu'ils gardent pour eux et n'ont « jamais donné l'argent aux parents ». M qui ne reçoit « qu'un peu d'argent pour aller au bal ou au pardon » se souvient de l'été vers 1954-1955 qu'elle passe « toute la journée à équeuter le sac de haricots verts destiné à la conserverie. Et avec le travail que j'ai fait pendant l'été j'ai pu m'acheter un manteau, c'est tout. » En effet, sa mère a déjà acheté le trousseau et ne « peut pas payer un manteau neuf pour la rentrée. » Dans ces villages bretons de la fin des années 1950, les jeunes n'ont donc pas encore goûté les fruits de la société de consommation, ils n'ont donc pas le pouvoir d'achat et l'indépendance financière indispensables à l'acquisition des objets emblématiques de la culture jeune.
La culture des jeunes, une culture jeune ? Pour eux, la vie à la ferme est difficile et la maison familiale peu avenante au point que l'école ou le lycée peuvent apparaître comme des refuges plus hospitaliers. Al, interne à Pont-l’Abbé avoue être mieux au lycée qu'à la maison, car « à la maison on n’avait rien ». MT elle aussi « préférait être à l'école à Quimper ». C n'a que peu vécu chez elle puisqu'elle est en pension « chez les religieuses de 4 à 14 ans », ce qu'elle a plutôt bien vécu car elle y « était très heureuse ». Au contraire, ce qu'elle regrette, c'est de ne pas « pouvoir aller à Kermaria chez les religieuses à cause du refus de son père » et elle reprécise bien « moi je me plaisais à l'école, je me plaisais en pension. » Pourtant le cadre scolaire reste rigide : permet-il vraiment de forger une identité juvénile ? « Je préférais être à l'école » Tous ces jeunes sont évidemment passés par l'école primaire qui reste une étape décisive qui les a souvent marqués.
L'école n'est pas pour autant une évidence dans toutes les familles. Au début des années 1950, Y, née en 1944, n'est pas scolarisée : « Ma grand-mère se disait : elle a le temps d'aller à l'école ». C'est l'intervention du maire de la commune qui la pousse sur les bancs de l'école : « Il avait eu écho par quelqu'un qui lui avait dit la petite fille de Mme N ne va pas à l'école. Moi ça me dérangeait pas. Et donc je vois le maire arriver chez la grand-mère et lui dire, vous savez l'école est obligatoire, il faut que Y aille à l'école. Et donc le lundi suivant c'était la Toussaint, je suis allée à l'école. » Mais le plus souvent c'est à la fin de la scolarité obligatoire, dès le certificat d'études en poche, que surviennent les difficultés. Plusieurs de ces jeunes doivent abandonner les études, car les parents, surtout le père, refusent. MT et C regrettent : « si j'avais pu, je serais allée à l'école ». Y ne cache pas non plus son amertume car « j'apprenais bien à l'école » et « j'avais insisté pour apprendre à coudre (…) mais il fallait quand même trois ans pour avoir un CAP ». Toutes les trois se heurtent à un refus. La mère de Y lui assène qu'elle « n'a qu'à travailler, elle gagnera » : « Donc à 15 ans je suis allée travailler. C'était raide hein. » Les parents de MT refusent aussi qu'elle continue après son CAP, tout comme le père de C. Les raisons sont toujours financières. Pour C : « une petite sœur cadette, l'aînée est mariée et la maman malade. Donc il fallait rester travailler à la maison. » MT elle n'a « pas bourse entière. C'est ça le problème. » Quant à Y, « la grand-mère trouvait à dire qu'elle avait pas à payer pour moi ou qu'elle ne pouvait pas. S’il fallait qu'elle aille travailler pour me donner de quoi aller tous les jours à Guingamp, elle pouvait pas. » Les autres jeunes gens, sauf Re, sont boursiers, ce qui leur permet de poursuivre les études jusqu'à 18 ans. Le père de Al approuve la poursuite de sa scolarité, au point qu'à l'obtention de son brevet en 1958 il « était tellement fier, il a dit bon ben on va acheter une motocyclette ». R, lui, insiste bien sur le rôle de son instituteur qui a réussi à surmonter l'opposition familiale : « Ma mère ne voulait pas que je suive des études car il y avait la ferme. C'est l'instituteur qui m'a poussé à continuer et qui est allé voir ma mère. » Mais il reconnaît aussi avoir eu un peu de chance car « le frère n'aimait pas bien l'école. Donc il a été gardé pour travailler à la ferme. » Y n'a pas eu cette chance car les religieuses de son école lui disent « vous allez aller à l'école à Bégard, vous irez en 6e », mais elles n'ont pas pu faire fléchir la détermination de la mère et de la grand-mère.
Les jeunes gens qui fréquentent le lycée ne gardent pas un mauvais souvenir de ces années. L'austérité de la vie à la ferme rend l'internat plus supportable, malgré la rareté des retours à la maison, uniquement lors des vacances et parfois pour « les grandes sorties », au mieux une fois par mois. M se souvient du rythme au lycée Brizeux à Quimper : « une grande sortie, trois jours à la Toussaint pour rentrer chez soi et après Noël ». A Rennes, « c'était le trimestre complet jusqu'à Noël » pour MA. De même, la discipline, « très stricte » à Brizeux et Rennes pour les jeunes filles, mais plus souple pour les garçons à Rennes et Pont-l’Abbé, ne révolte pas les adolescents. Chez eux le régime n'est pas moins sévère pour C et MA qui ont des « parents très stricts et le père était très dur ». Au moins, au lycée, ils disposent de quelques moments de liberté, le dimanche, qui n’existent pas à la ferme. MT et M se souviennent des promenades dominicales le long de l'Odet, certes soigneusement encadrées par les surveillantes, mais qui permettent parfois de croiser les lycéens : « Le dimanche y avait la promenade, c'était la sortie jusqu'au bout du hallage au Corniguel. Parfois on trouvait les gars du lycée. Les surveillants disaient rien. » M n'a pas la chance de MT car « la directrice était très sévère », elle « téléphonait pour savoir dans quelle direction allaient les garçons pour ne pas les croiser. » A Rennes, MA se souvient des « sorties en groupe à La Prévalaye ». De plus les lycées de Quimper proposent à leurs élèves des loisirs inconnus dans les campagnes bigoudènes : « le théâtre, mais chacun payait sa place ». M se souvient y avoir vu Le Grand Valet de Pierre Jakez-Hélias. Pour MT les occasions sont plus rares, « il y avait parfois le théâtre mais j'y allais pas car j'avais pas d'argent, et beaucoup étaient dans mon cas, sauf une fois, on m'avait payé ma place ». Les codes vestimentaires sont aussi rigoureux, surtout pour les lycéennes. MA n'avait pas d'uniforme à Rennes, mais toute extravagance et les couleurs sont bannies, comme les pantalons. A Quimper, « le trousseau est très onéreux pour les familles, mêmes boursières. L'uniforme est de rigueur, fourni par les familles, blouse bleue obligatoire, socquettes blanches, col blanc, uniforme bleu marine et casquette sur la tête. » En revanche, D et Al au lycée de Pont-l’Abbé ne sont astreints qu'à la blouse grise.
Les conditions de vie à l'internat, dures pour certains, ne gênent pas les adolescents qui ne connaissent pas mieux chez eux. Ainsi MT doit « traverser Quimper entre les dortoirs au Séminaire et les repas là-bas, route de Brest », mais tous ont l'habitude d'aller à l'école à pied, parfois distante de plusieurs kilomètres, comme R qui « allait à l'école à Melrand, parce qu'à Bubry c'était plus loin ». Quatre kilomètres pour y aller, mais quand il part au Lycée à Pontivy, il parcourt les 21 km qui le séparent de Bubry à vélo. MA avait « 30 minutes de marche pour atteindre l'école. Bien pénible l'hiver. » L'internat du lycée de filles est donc bien plus confortable, d'autant qu'elle y découvre l'eau courante, luxe dont elle ne dispose évidemment pas chez elle. « C'était le bal et les fêtes locales » Pour tous ces jeunes, les vrais moments de distraction et de liberté sont les bals, partout organisés le dimanche soir. Ils concernent toutes les communes, pour des occasions extrêmement variées. Ils accompagnent systématiquement les festivités communales, les fêtes religieuses, les fêtes sportives, puisque les clubs aussi organisent le leur. Les jeunes sont toujours au courant des différents bals de la région et apprécient la réputation musicale des uns ou des autres, « ceux de Plonéour et de Plogastel sont particulièrement recherchés ». La tradition est si bien établie que le directeur d'école de A lui accorde le lundi matin pour lui permettre de fréquenter le bal du dimanche soir. Les salles sont souvent rustiques. À Pédernec, Y se souvient du barnum élevé près du bourg. À Pouldreuzic, c'est l'entrepreneur local qui prête son hangar pour permettre aux jeunes de danser sur le ciment. L'engouement des jeunes pour aller danser entraîne la multiplication des salles. Certains cafés n'hésitent pas à aménager sommairement une arrière-salle pour y faire danser la jeunesse. R se souvient « des trois salles de bal à Bubry, principalement dans les cafés ». De même MT se souvient d'un cousin de son futur mari qui « avait fait construire une salle de bal moderne, à Pendreff ». A cette occasion la modernité fait une entrée discrète et les bals avec orchestre sont peu à peu remplacés par les disques. MT se souvient qu'à la fin des années 50, elle allait à « des bals pick-up, comme on disait », c'est-à-dire avec une « sono moderne » comme chez le cousin de son mari. Plus traditionnels mais très répandus, et encore plus fréquentés : les bals de noces, qui accompagnent systématiquement les mariages. Ils se déroulent en fin d'après-midi avant le repas du soir et ils sont ouverts à tous. Surtout, ils sont gratuits, ce qui ne manque pas d'attirer les plus jeunes. MT qui adore danser, les fréquente dès l'âge de 14 ans.
Le plus souvent c'est à partir de 16, 17 ans, que les jeunes prennent l'habitude d'aller danser, sans que les parents puissent vraiment s'y opposer. Ils se contentent de fixer une heure de retour. Mais c'est surtout avec leur fille qu'ils sont les plus intransigeants. MT se souvient d'ailleurs de la réaction violente de son père quand il s'est rendu compte que sa fille n'avait pas respecté l'horaire. Mais ces jeunes filles sont aussi capables de mettre en place d'habiles stratégies familiales pour dissimuler leurs escapades au bal. MT n'hésite pas à aller dormir chez sa sœur mariée pour rester plus longuement sans avoir à subir les foudres parentales. C, dont le père interdit la fréquentation des bals, profite de son travail à la conserverie pour partir dès le dimanche soir et contourner ainsi l'interdit paternel. De même, quand elle assure le service lors des mariages, elle peut rester danser sans que son père puisse s'y opposer. « La java bleue » ou « Johnny Hallyday » ? Le bal reste le principal vecteur de la culture musicale des jeunes. Les radios et électrophones ne font pas encore partie de la panoplie des adolescents. Personne n'a le souvenir d'avoir eu, ni même vu dans son entourage, un électrophone. Pourtant apparus dans le milieu des années 50, ils restent, comme les disques, totalement absents de l'univers culturel des jeunes. Y fait figure de pionnière en 1960, car « n'ayant pas de radio à la maison, j'ai acheté un poste de radio, un poste à piles. Je me rappelle bien, dans une pochette synthétique, pour mettre sur l'épaule, pour l'amener avec moi au boulot. » Presque à la même date, R se procure sa première radio mais « achetée en arrivant à Paris ». Pour les autres, la radio, pas toujours accessible est celle de la famille, comme l'avoue R qui « n'osait pas trop y toucher ». M se souvient aussi de ces « gros postes posés sur une étagère pour que les enfants n'y touchent pas ». Le poste est parfois arrivé avant l’électricité, Y et R se souviennent des accus. Re est le seul à pouvoir retrouver une émission qu'il écoutait dans sa jeunesse : « Cousine Odette », diffusée sur Radio Bretagne jusqu'en 1964. Toutefois, son souvenir reste plus attaché à l'enfance qu'à l'adolescence. A Pouldreuzic vers le milieu des années 50, ce ne sont pas les jeunes et leurs émissions qui poussent à investir dans l'achat de la radio se souvient M mais « les dames passaient avec leur sac à provisions et un poste dedans, acheté à un électricien de Pouldreuzic, pour écouter les sketches radiophoniques de Pierre Jakez-Hélias ». En tout cas, en 1958, la culture yéyé n'a pas encore envahi l'espace sonore de la ferme. La seule à y faire explicitement référence est Y, plus jeune, elle est exactement de la même génération que Sylvie Vartan, Johnny Hallyday ou Sheila, dont elle se souvient, mais plutôt pour le début des années 1960. Avant, elle a partagé la culture musicale des autres jeunes, incarnée par l'accordéoniste Aimable, qui sillonne la Bretagne dans ces années. Ces références musicales s'acquièrent exclusivement dans les bals, animés par des orchestres de musiciens amateurs ou professionnels comme ceux d’Aimable ou Yvette Horner, l'autre vedette de l'accordéon. MT se souvient ainsi avoir dansé sur les airs d'Aimable et son orchestre réputé qui attirait les foules adolescentes de la région de Penmarc'h. M, Al et D, sans être aussi précis, évoquent à leur tour l'accordéon, base de leur culture musicale, qui appartient plus à une culture populaire largement partagée qu'à une culture spécifique à la jeunesse. De même, aucun n'évoque la moindre revue, le moindre journal pour jeunes, auquel ils auraient pu avoir accès. Il est vrai que Salut les copains n'est pas encore apparu chez les marchands de journaux. Ouest-France est le seul journal qu'ils se souviennent avoir vu dans la cuisine. Les parents de M et D « l'achetaient le mardi et le vendredi, pour avoir les cours du porc à la Villette ». MT et Re font allusion à d'autres journaux, sans être bien sûrs des titres. De toute façon c'est d'abord le journal des parents, qu'ils ne feuillettent qu'occasionnellement, et non celui des jeunes. « Quand on est fille de cantonnier, on ne regarde pas le fils du patron » Si le bal est un haut lieu de culture, c'est aussi un lieu de la sociabilité des jeunes, mais il n'échappe pas à certaines tensions sociales. Car appartenir à une même génération ne suffit peut-être pas à effacer les différences de classes. R préfère éviter les bals de sa commune et fréquenter ceux des villages voisins, où sa condition modeste est inconnue. À Bubry, les filles du bourg refusent de danser avec lui, à cause de sa « situation sociale assez basse » et même d'une façon générale « les jeunes des quartiers56 n'étaient pas acceptés dans le bourg de la commune ». Le breton semble aussi un puissant critère ségrégatif. Plusieurs témoins se souviennent des refus successifs essuyés par les jeunes gens qui invitent, en breton, les jeunes filles à danser, du seul fait donc qu'ils s’expriment dans cette langue ».
Appartenir à une même classe d'âge ne permet pas de s'affranchir des barrières sociales comme s'en souviennent M et Al à propos de la même histoire survenue à Pouldreuzic. Une ouvrière de l'usine Hénaff se fait publiquement gifler par le patron de la conserverie parce que son fils la courtise. Or la violence paternelle est approuvée par le village qui rappelle la norme : « quand on est fille de cantonnier, on ne regarde pas le fils du patron ». Preuve que les identités sociales restent plus puissantes que les identités générationnelles, et « la jeunesse, un mot »57. De même les bals et la sociabilité juvéniles sont étroitement surveillés par la communauté villageoise. R déplore qu'à Bubry c'est « très surveillé. Tout était vu et dit. » MT partage la même expérience : « tout se savait », et précise « Les bals de noces, là tu voyais les vieilles qui venaient voir qui était avec qui. Pareil pour les pardons. » C'est aussi « une dame qui avait dit à sa future belle-mère, je crois qu'E fréquente, mais elle est bronzée », façon explicite d'évoquer ses origines paysannes. D'une manière beaucoup moins violente, A est aussi témoin de ces sociabilités spécifiques qui se croisent sans vraiment se rencontrer. Avant son mariage, elle fréquente comme d'autres jeunes gens de Châtelaudren, « l’hôtel du commerce où je mangeais aussi car je n'avais pas de quoi faire ma tambouille ». C'est d'ailleurs là qu'elle rencontre son mari qui « lui aussi y prenait ses repas tous les jours ». Or, elle a bien remarqué la disposition des tables, « à midi une très grande table au milieu de la salle pour les ouvriers du Petit Echo, la table des notaires (en fait les employés) », elle et le préparateur en pharmacie sur une autre table. Sans qu'elle puisse affirmer qu'il n'y avait que des jeunes gens, elle remarque bien que les différentes tablées ne se rencontrent pas vraiment, même si elle avoue « avoir sympathisé avec la table des notaires ». De même à Pouldreuzic, la fréquentation des bistrots semble plus correspondre à des logiques sociales que générationnelles. Al précise que les ouvriers se retrouvaient après le travail, plutôt « dans les cafés à côté de l'usine », les paysans fréquentaient celui qui « faisait bureau de tabac et assurances agricoles ». Sans que l'on puisse en faire un lieu spécifique car « tout le monde y allait », les jeunes préfèrent chez Germaine où l'on peut profiter « d'un juke box ». Enfin Re, lycéen à Rennes, ne se souvient guère avoir fréquenté les cafés rennais, ni même ses camarades de lycée « plus bourgeois » que lui. Les jeunes sont donc encore loin de former un groupe homogène et cohérent.
Néanmoins dans cette fin des années 1950, les jeunes veulent échapper à l'encadrement villageois et cherchent timidement des espaces de liberté. C'est peut-être ce qui fait le succès des bals dans les salles, car à la différence des bals de noces, ouverts à tous, « c'était autre chose. On avait quand même plus de liberté » se souvient Al. L'espace public, gratuit, à la différence des cafés, peut accueillir la sociabilité « d'une bande de copains », comme l'évoque MT. Elle connaissait bien ce groupe qui habitait Léchiagat et « se retrouvait sur le bout du pont, entre Guilvinec et Léchiagat. Ils allaient même pas au bistrot. Ils restaient au bout du pont, dehors. » En revanche, le cinéma, autre vecteur de la modernité culturelle est encore loin de pouvoir détrôner la place des bals dans le divertissement et la sociabilité des jeunes. Pourtant les salles existent dans les petites villes. MT connaît celui de Penmarc'h mais avoue ne pas y aller, « trop cher ». Y savait où était le cinéma à Lannion mais ne se souvient pas y être allée. L'obstacle n'est pas financier comme pour MT mais d'un autre ordre « non, non pas de cinéma, il fallait oser y aller au cinéma ». Seul R se souvient de fréquenter assez régulièrement celui de Pontivy, quand il était au lycée, il se rappelle un western qu'il a pu y voir, Kit Carson. Mais le réseau des cinémas ne peut rivaliser avec celui des salles de bal. A Bubry le patronage projette des films, mais en même temps le bourg compte trois salles de bal. « On va acheter une mobylette » Ces loisirs limités au bal et cette culture traditionnelle bien éloignée des innovations sonores de Saint-Germain-des-Prés sont à associer à une forte sédentarité. Pour les jeunes, l'espace vécu et fréquenté ne dépasse guère les limites du canton car ils ne peuvent aller plus loin, faute de moyens de transports. Inutile de parler de la voiture, en 1958 elle reste le privilège des notables des petites villes, même si le père de C « a eu une voiture assez tôt, en 1957 ». Mais sa fille n'a pas l'occasion d'en profiter, « il s'en servait tout seul ». Pour les jeunes l'accès à la voiture se produit justement au moment où ils quittent cet âge intermédiaire, premier signe d'une installation dans le monde des adultes. R, qui travaille chez Citroën, achète sa première voiture, une deux chevaux (2CV) évidemment, après son mariage, en 1964. Le mari de MT opte lui pour une quatre chevaux (4CV), mais il est déjà instituteur. Au mieux les jeunes peuvent espérer une mobylette comme Al qui en reçoit une après son succès au brevet . Re dispose d'un petit pécule à la mort de son père, avec lequel il peut s'acheter un scooter. Mais il est déjà sur le point de quitter la Bretagne. C'est d'ailleurs en Vespa qu'il fait le trajet de Saint-Germain-sur-Ille à Paris, une première fois en 1959, puis à nouveau un peu plus tard au début des années 60 avec sa femme : « On est remonté à Paris, en Vespa, on a pris la flotte tout le long de la route, avec une guitare entre elle et moi ». Pour les autres, le seul moyen de sortir du village et d'atteindre les communes environnantes reste le vélo, dont presque tous disposent. Même si R possède un vélo de course avec trois vitesses, avec lequel il peut aller jusqu' à Pontivy, la capacité de déplacement est limitée. C, confie : « On avait des vélos mais ça faisait loin quand même ». Ces jeunes ne sortent donc que rarement de leur environnement familier. Seules des occasions permettent à quelques chanceux d'aller plus loin. Al peut découvrir Paris lorsqu'il va chercher, en train, les enfants d'une colonie de vacances qu'il encadre. De même, Re passe deux mois et demi dans une colonie de vacances en tant que moniteur, à Paramé.
L'engagement politique des jeunes Pour ces Bretons la jeunesse se passe donc dans un espace géographique limité, où ils baignent dans une culture somme toute traditionnelle, encore peu touchée par la modernité. Mais la Bretagne n'est pas isolée du monde et ne peut rester à l'écart des bouleversements qui marquent l'année 1958. Le retour au pouvoir du général De Gaulle ne touche pas directement ces jeunes gens qui n'ont pas encore acquis le droit de vote, mais les unes d’Ouest France, présent à la maison, ne peuvent les laisser dans l'ignorance. Pour autant, perçoivent-ils l'importance de l'événement ? En revanche les événements d'Algérie, qui sont aussi à l'origine du retour du Général, les touchent directement. Ces moments forts, qui forgent l’identité d’une génération58 et auxquels les historiens sont si attachés, le furent-ils tant que ça à Rennes ou Plozévet, Bubry ou Pédernec ? « Ma mère ne savait pas pour qui elle votait » Aucun des différents témoins n'a gardé un quelconque souvenir marquant du changement de régime survenu en 1958. Pourtant Re et MA ont des convictions politiques et un engagement militant même s’ils sont les seuls du corpus. Re se souvient très vaguement avoir participé à une manifestation sans pouvoir être plus précis, preuve que ce n'est pas pour lui un événement notable. MA, qui travaille déjà à Paris, ne se souvient pas non plus d'une activité importante : « Dans la boîte où je travaille, je suis la seule concernée. Je vais pas faire grève toute seule. »
De même A, 26 ans en 1958 et donc en âge de voter, ne s'attarde pas sur cette année-là qui ne lui a rien laissé de bien marquant. Pourtant au même moment son mari s’intéresse à la politique locale : « il s'est rapproché du maire et est entré au conseil municipal ». A, elle, semble rester en dehors. Son seul souvenir du général De Gaulle est une image fugace, mais qui date en réalité de 1960 : « Je l'ai vu quand il s'est arrêté à Châtelaudren. Je regardais depuis le balcon de la perception. » Pour les jeunes, le rapport à la politique est lointain, comme pour les parents. Dans les fermes les débats sont absents. M est catégorique « pas de politique à la maison », tout comme chez MT : « Le père suivait mais il n'y avait pas de discussions ». Le plus souvent la politique se limite aux affaires locales et la seule personnalité qui suscite des commentaires est le maire. A Bubry « On discutait politique locale. Le maire avait droit à son chapitre. » Aucun ne se souvient, ni en 1958, ni à un autre moment, avoir assisté à de virulents débats entre adultes. De même, les femmes qui ont le droit de vote l'utilisent mais sans le maîtriser. MT se souvient de sa mère qui « ne savait pas pour qui elle votait. Le père lui donnait le bulletin avant de partir. » A Pédernec, c'est Y qui exerce le droit de vote pour sa grand-mère. Elle rappelle en riant « je vote depuis que j'ai huit ans ! », « pourtant avec De Gaulle il y en a eu des référendums avec oui ou non, mais elle aurait pas su lequel était le oui et le non ». En effet sa grand-mère ne sait ni lire ni écrire et ne parle que le breton, c'est donc Y qui vote : « je mettais le papier dans une enveloppe à la grand-mère et elle allait voter ». Et d'ajouter : « Elle était pas la seule comme ça ». « Il est en Algérie. C'est tout » Pour ces jeunes bretons, l'arrivée au pouvoir de De Gaulle s'apparente plus à un non-évènement. Ce n'est pas cette histoire-là qui façonne cette génération. La guerre d'Algérie est plus présente. Tous, garçons et filles, se souviennent d'un proche ou d'un voisin qui est parti « là-bas ». Y ne cache pas une certaine émotion quand elle parle de ce jeune homme de Pédernec « qu'on connaissait très bien, qu'on côtoyait. Il a été tué en Algérie. Il était venu en perm' et 15 jours après qu'il est reparti en Algérie, il a été tué, en Algérie, 20 ans qu'il avait. » Mais l'expérience algérienne reste largement dans le non-dit. Certains reconnaissent en parler entre eux et en famille mais personne n'a en mémoire la nature des propos tenus. Mais chez M « il ne fallait pas en parler à la famille ». De même, le courrier de ceux qui sont partis reste rare et épisodique, le contenu des lettres ne semble rien révéler de précis, au mieux des allusions difficiles à décrypter. Seule MA se souvient du courrier envoyé par son frère qui lui faisait la morale, connaissant son hostilité à cette guerre que lui au contraire défend. Quant à ceux qui rentrent, ils se réfugient dans le mutisme. Ainsi les copains de A : « En rentrant ils avaient du mal à en parler. Ce n'est que beaucoup plus tard, quand ils avaient un coup dans le nez. » Le témoignage de R, révèle bien ce culte du silence qui affecte toute une génération : « La guerre d'Algérie, les gens qui étaient revenus n'en parlaient pas. Mon frère était à la guerre d'Algérie, j'ai jamais pu lui tirer un mot. » De plus, ni D, ni A, ni R ou Re n'ont participé directement à la guerre. Les uns, sursitaires, y échappent, les autres sont exemptés ou font leur service à l'Etat-Major à Paris. Le seul contact de Re avec la guerre d'Algérie est d'« d'envoyer les revues en Algérie, dans les foyers ». Il est le seul à avouer s'être modestement engagé contre la guerre. Au lycée avec un groupe de camarades, « pas plus d'une dizaine », ils rédigent des petits tracts diffusés au sein de l'établissement mais qui ne rencontrent pas un grand écho parmi leurs camarades. « Les élèves ne disaient rien », reconnaît-il. L'administration probablement au courant laisse faire discrètement, car « les élèves n'ont pas adhéré du tout ». Son engagement ne va pas au-delà car « je n'ai pas de souvenirs de manifs contre l'Algérie ».
L'engagement partisan de ces jeunes reste d’ailleurs exceptionnel. Seul Re a une activité militante au parti communiste. Cet engagement n'est vraiment significatif qu'à son arrivée à Paris. Là il participe aux réunions de cellule et ne manque pas la fête de l'Humanité. Il se souvient assez bien de son cheminement et de son engagement progressif qui ne doit rien au milieu familial. C'est son voisin à Saint-Germain-sur-Ille, dont il côtoie les enfants, qui discute avec lui et lui donne « des choses à lire » et qui finalement « l'a un peu converti ». Une fois arrivé au lycée, il poursuit une discrète activité militante, avec un groupe d'une dizaine de copains, avec lesquels il se souvient avoir collé des affiches et s'être frotté de loin à ce qu'il appelle « les fachos ». Sans qu'il établisse un lien précis, l'engagement vers le parti communiste passe peut-être par la colonie de vacances de Paramé, qu'il fait comme moniteur dans un établissement tenu par une fédération de résistants, probablement l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, proche du PCF. MA a elle aussi un engagement au parti communiste. C'est sa copine Maryvonne, dont elle est très proche et avec qui elle est montée à Paris, qui l'amène à un engagement partisan qui ne se déroule que dans un cadre parisien. « j'aurais dû tailler la route » Mais 20 ans n'est pas que l’âge des expériences, c'est aussi celui des choix à faire, des routes à emprunter. En 1958, elles ne passent plus obligatoirement par les « chemins creux » du penty. Aucun de ces jeunes ne reprend la ferme familiale. AM, Re et R, comme tant d'autres Bretons, ont bien compris que bezañ ugent vloaz en e bennti menait à une impasse. Ils préfèrent prendre la route de Paris, même si c'est en scooter comme Re, et ils n'en éprouvent aucun regret. A l'inverse, les Bigoudens M, D et A font le choix de rester. L'un avoue être « une vraie bernique », l'autre pour ne « pas être trop loin des parents, pour les aider », mais peut-être aussi parce qu'ils sont sortis de la ferme pour intégrer l'Education nationale. Forts de cette ascension sociale qui fait la fierté des parents, ils peuvent affirmer leur identité et leur culture bretonnes, à laquelle M est tout particulièrement attachée. Mais pour MT, C et Y, le départ est impossible, bien qu'il les taraude. MT répète à plusieurs reprises « j'aurais dû partir, j'aurais dû tailler la route, mais il faut de l'argent ». Les regrets sont les mêmes pour C : « Oh que si j'aurais voulu partir. Mais pour pouvoir partir, il aurait fallu de l’argent. Et puis je pouvais pas laisser ma petite sœur et ma mère qu'étaient pas en bonne santé. J'aurais pas pu partir et les laisser, mais l'envie était là. » Ces remords sont d'autant plus vifs qu'elle en connaît qui ont réussi à échapper aux contraintes familiales « J'avais des cousines qui étaient parties. Je les enviais. Elles venaient en vacances chez leurs parents. On se disait qu'elles avaient de la chance. » En revanche, Y, plus résignée, n'a jamais vraiment envisagé de partir : « J’avais pas envie d’aller plus loin (Begard). Non. Pas plus que ça. Je me plaisais bien (à Bégard). Je travaillais, j'avais mon salaire » Mais elle ne manifeste aucun attachement particulier à sa région natale et rejette même catégoriquement la culture bretonne de son enfance : « Après, le breton, j’ai eu ça en horreur. Faut pas m'en parler, hein ! » Pourtant, aucun n'ose remettre en cause l'autorité familiale, aucun sentiment de révolte à l'égard des aînés, souvent décrits, comme chez A « très stricts, le père était très dur ». De même les décisions ne sont jamais discutées, que ce soit lorsque le père de C, la grand-mère de Y, les parents de MT refusent la poursuite des études ou lorsque la mère de R refuse de payer la licence qui lui permet de faire des courses de vélo. Dans ces conditions le départ vers Paris a aussi un goût de liberté : « Paris, c'était la liberté » avoue AM.
Finalement, pour ces jeunes, avoir 20 ans, en Bretagne, dans la ferme familiale n'a pas forcément le goût de la modernité. Leurs jeunes années sont plus empreintes de la culture traditionnelle que de la culture juvénile identifiée par Edgar Morin dans le Plozévet des années soixante59 : une vie rude et laborieuse, avant même vingt ans, R en sait quelque chose, « à partir de 12 ans je trayais les vaches, avant d’aller à l'école fallait traire, lever 5 heures, départ 8 heures, école à 9 heures », des loisirs plus proches de ceux des parents que des jeunes snobs des caves du quartier latin, une langue bretonne qui sépare plus qu'elle ne rassemble. Quand de Gaulle arrive au pouvoir, « l'identité adolescente » de ces jeunes n'est pas vraiment marquée du sceau de la modernité, comme le pensait Edgar Morin60. Il faut attendre encore quelques années pour que ces jeunes Bretons rencontrent ces « années décisives, 1957-1962 »61. Mais cette conclusion ne peut être définitive. Elle est plutôt à prendre comme une hypothèse et un appel à entamer une étude plus large et systématique que celle proposée ici. Ce décalage chronologique est-il propre à la Bretagne rurale ou se retrouve-t-il ailleurs ? De même, à la fin des années 1950, les jeunes citadins bretons issus des classes moyennes et de la bourgeoisie ont-ils déjà adopté la culture jeune des avant gardes parisiennes ? Jean-Christophe BRILLOIT Professeur en classes préparatoires au lycée de Cornouaille (Quimper)
1 CHEROUX, Clément (dir), Magnum, Manifeste, Paris, Actes Sud, 2017, p. 92. 2 MORIN, Edgard, Commune en France, la métamorphose de Plozévet, Paris, Hachette, 2013 (1e éd. 1967). 3 Le Monde, 6 juillet 1963. 4 MORIN, Edgard, Commune en France, … op. cit., chapître 7 : « Jeunes et vieux ». 5 Ibid p. 191. 6 Ibid. 7 BOURDIEU, Pierre, « la jeunesse n'est qu'un mot », in BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 143 et suivantes. 8 BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge? : Jeunes et jeunesses en France de l'aube des Trente Glorieuses à la guerre d'Algérie, Paris, Fayard, 2007, p. 12. 9 Ibid., voir notamment l'introduction. Les plus pressés peuvent se reporter à la contribution de Ludivine Bantigny « Le mot jeune, un mot de vieux » in BANTIGNY, Ludivine et JABLONKA, Ivan (dir.), Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France, XIXe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2009. 10 HERODOTE, Enquête, Paris, La Pléiade, 1964, II-123. 11 THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, Paris, La Pléiade, 1964, I-22. 12 BECKER, Jean-Jacques, « Questions à l’histoire orale. Table ronde de 1986 », Cahiers de l’IHTP, n°4, 1987, p. 95-99. 13 JOUTARD, Philippe, Ces voix qui nous viennent du passé, Paris, Hachette, 1983. 14 A titre d’exemple, LE GALL, Erwan, « Dans la Chambre claire d’Alexandre Mounicot. Réflexions barthiennes sur un fonds de photographies privées de la Grande Guerre », En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°9, hiver 2017, en ligne. 15 DESCAMPS, Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2005. Disponible en version électronique, consultée en mai 2017, http://books.openedition.org/igpde/104. 16 BANTIGNY, Ludivine et JABLONKA, Ivan, Jeunesse oblige…, op. cit., p. 5. 17 Ibid, p. 6 et suivantes. 18 BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge ?..., op. cit. 19 SOHN, Anne-Marie, Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes des années 1960, Paris, Fayard, 2012. 20 VERGNIOUX, Alain et Lemonnier, Jean-Marc., « Les adolescents des années soixante: salut les copains ! », Le Télémaque, vol. 38, n°2, 2010, p. 87-100. 21 BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge ?..., op. cit. 22 BANTIGNY, Ludivine et JABLONKA, Ivan, Jeunesse oblige…, op. cit., préface de SIRINELLI, Jean-François, p. 2. 23 Cf. http//www.imec-archives.com. 24 La base de données de ces archives sonores est accessible via le site Dastum : http//www.dastum.bzh. 25BANTIGNY, Ludivine et JABLONKA, Ivan, Jeunesse oblige…, op. cit., préface de SIRINELLI, Jean-François, p. 2. 26 MORIN, Edgar, Commune en France…, op. cit. 27 DESCAMPS,Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone…, op. cit, 4e part., chap. 1, paragraphe 40 en ligne]. 28 WEBER, Florence et BEAUD, Stéphane, Guide de l'enquête de terrain, Paris, Editions de la Découverte, 1997. 29 Notamment en les comparant aux données et analyses avancées dans BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge ?..., op. cit. 30 MORIN, Edgar, Commune en France…, op. cit. 31 BEAUD, Stéphane, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'entretien ethnographique », Politix, 1996 n° 35, p. 226-257. 32 GINZBURG, Carlo, Le fromage et les vers. L'univers d'un meunier du XVIe siècle, Paris, Aubier, 1980. 33 CORBIN, Alain, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, Paris, Flammarion, 1998. 34 LE GALL, Erwan, La courte Grande Guerre de Jean Morin, Spézet, Coop Breizh, 2014. 35 BEAUD, Stéphane, « L'usage de l'entretien … », art. cit., p. 234. 36 MORIN, Edgar, Commune en France…, op. cit., et BURGUIERE, André, Bretons de Plozévet, Paris, Flammarion, 1977. 37 BEAUD, Stéphane, « L'usage de l'entretien … », art. cit., p. 234. 38 DESCAMPS,Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone…, op. cit,, part. 3, chap. 3, paragraphe 13 [en ligne]. 39« L'anecdote est un formidable révélateur et analyseur de situations sociales », in Beaud, Stéphane, op cit, p. 243. 40 DESCAMPS,Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone…, op. cit, 3e part., chap. 3, paragraphe 6 [en ligne]. 41 Ibid, 3e part., chap. 3, paragraphe 14 [en ligne]. 42 Ibid, 3e part., chap. 4, paragraphe 3 [en ligne]. 43 Ibid. 44 Ibid, 3e part., chap. 4. paragraphe 17 [en ligne]. 45 Ibid. 46 PAILLARD, Bernard, « A propos de Plozévet. Retour sur une polémique académique », Hermès, vol. 60, n°2, 2011, p. 176-181. 47 DESCAMPS, Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone…, op. cit, 3e part., chap. 5, paragraphes 24-25 [en ligne]. 48 BURGUIERE,André, Bretons de Plozévet…, op. cit., p. 159. 49 DESCAMPS, Françoise, L’historien, l’archiviste et le magnétophone…, op. cit, part. 3, chap. 3, paragraphe 22 [en ligne]. 50 BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge ?..., op. cit., p. 13 51 Pour prolonger la réflexion se rapporter à PERRONO, Thomas, « Les Bretons de Paris face au concept de diaspora », En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°6, été 2015, en ligne. 52 SAUVY, Alfred, La montée des jeunes, Paris, Calmann-Lévy, 1959. 53 GIROUD, Françoise, La Nouvelle Vague, portraits de la jeunesse, Paris, Gallimard, 1958. 54 SIRINELLI, Jean-François, « Jeunes », in RIOUX, Jean-Pierre et SIRINELLI, Jean-François, La France d'un siècle à l'autre », Paris, Hachette, 1999, t. 2, p. 25. 55 BURGUIERE,André, Bretons de Plozévet…, op. cit., p. 160. 56 Le quartier désigne dans la région de Bubry, la structure communautaire de travail. Il rassemble le nombre de personnes nécessaires à l'organisation des battages qui s'organisent entre elles et se retrouvent aussi pour des réunions plus conviviales le dimanche, créant ainsi une sociabilité de proximité. R précise « 7 fermes et 3 personnes par ferme. Donc il fallait 21 personnes pour un battage ». 57 BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie…, op. cit., p. 143-154 (la formule apparaît lors d’un entretien publié en 1978). 58 BANTIGNY, Ludivine, Le plus bel âge ?..., op. cit., p. 17. 59 MORIN, Edgar, Commune en France…, op. cit., p. 206. 60 MORIN, Edgar, Commune en France…, op. cit., p. 204. 61 « C’est au cours de ces années décisives, 1957-1962, que se réalise une dissociation capitale : le cinéma restera certes un spectacle juvénile, mais le star system cessera de jouer son rôle de modèle culturel dominant sur la jeunesse ». Cf. MORIN, Edgar, Les stars, Paris, Seuil, 1957, p. 147. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
 |