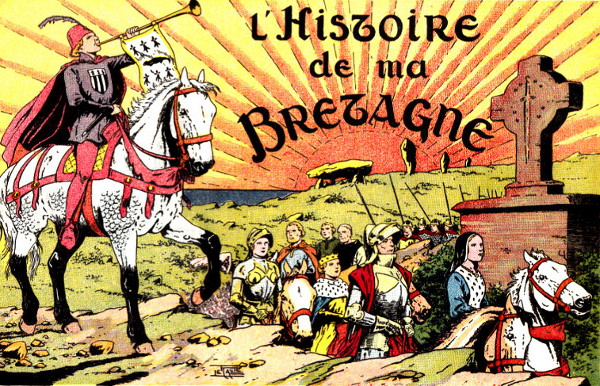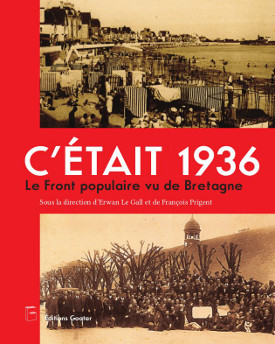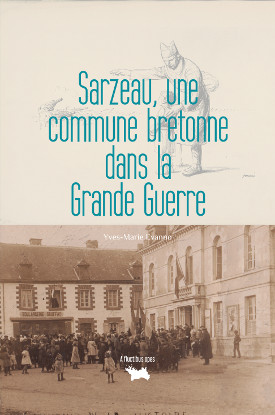|
|||||||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Origines, horizons, mondes défaits : quand commence l’espace breton ? De quelques rapports contemporains aux origines bretonnes
Rendre compte du passé procède d’insolubles injonctions contradictoires. S’il faut bien, pour rendre intelligible le récit, concéder une certaine linéarité, le propos ne doit pas tomber le piège d’un tube suggérant un début relié à une fin par un chemin unique et sans alternative. C’est cette difficulté méthodologique fondamentale que David Floch analyse à l’échelle de la Bretagne en partant de la célèbre Histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron. Par David FLOCH
La production des histoires nationales en Europe au cours du XIXe siècle a partout entraîné la quête d’une date de naissance. Celle-ci s’est traduite par l’invention d’origines fondatrices, en Bretagne comme ailleurs, inaugurant un récit national défini comme un continuum rendant compte de l’identité, à travers le temps et l’espace, de la nation prise pour objet1. Dans le cas breton, les productions de passé ont souvent hésité, pour le choix d’un moment fondateur, entre les migrations post-impériales et la mise en valeur de l’unité supposée du cadre armoricain depuis des temps plus reculés. Dans tous les cas, il allait de soi que l’ « Histoire de Bretagne » constituait un domaine de validité géohistorique et épistémologique immuable, dans lequel auraient coïncidé un espace et une histoire2.
A quelle géographie l’histoire bretonne correspond t-elle ? Pour quelle période l’espace breton armoricain fait-il sens ? Ce sont justement de telles questions que la notion même d’Histoire de Bretagne s’affranchit, postulant l’évidence d’un domaine de validité associé à un continuum armoricain. Envisager la Bretagne comme lieu d'histoires implique plutôt de se demander à quelles logiques géohistoriques se rattache l'espace identifié, à partir de 850, à une principauté périphérique. L'enjeu est justement de sortir du « récit tubulaire » 3 et de réfléchir aux géographies qui sont successivement opérantes et qui, reconfigurant ce que l'on se représente comme l'espace « breton » - auquel on prête depuis 1200 environ une cohérence et une intégrité (ethnique, politique, culturelle) naturalisées par les grands récits indigénistes du XIXe siècle – ont suscité des créations rétrospectives de passé. On observe ainsi une succession de « régions-périodes », correspondant à l’émergence de niveaux géographiques supérieurs englobant l’espace breton. Par exemple, la Bretagne de Nominoë et de ses successeurs est simultanément un monde très autonome – au point que les monastères de la seconde moitié du IXe siècle puissent s’inventer des origines indigènes dans l’ « âge des saints » – et très en interaction avec le monde carolingien englobant – puisque la Bretagne ne devient alors un « royaume » que dans le cadre de sa reconnaissance par l’autorité franque4. Monde carolingien, « Empire » plantagenêt, regnum Francie capétien firent émerger autant de niveaux géographiques correspondants qui stimulèrent des productions d’identité au sein de leurs composantes ainsi mises en relation dans un même ensemble spatial. La critique de l’ « idole »5 des origines comme objet de recherche historiographique est déjà ancienne. De même, les concepts qui en procèdent – l’ « Histoire de France », par exemple – ne relèvent plus du champ scientifique6. La fascination pour les origines, et pour le récit qu’elles permettraient de dérouler, est pourtant loin d’avoir disparu des rapports contemporains au passé. Elle tendrait même à augmenter à mesure de la médiatisation entourant les critiques faites à cette approche du passé. La « question » des origines bretonnes reste ainsi opérante, comme le suggèrent un phénomène tel que la « Vallée des Saints », mais aussi le fait que ce soit encore l’approche indigéniste qui domine la plupart des synthèses s’inscrivant dans le cadre « histoire de Bretagne ». Que ce soit au temps d’Arthur de La Borderie ou à celui de Joël Cornette, celles-ci cherchent en effet à « penser l’irréductible originalité d’un territoire », raconter l’« odyssée millénaire de cette singulière Armorique»7, comme s’il y avait effectivement une histoire à raconter. C’est aussi ce terrain qu’est récemment venue investir l’Histoire mondiale de la France (HMF) dirigée par Patrick Boucheron8. Chaque date choisie comme entrée y est l’occasion de rappeler la nécessité d’évacuer hors du champ historiographique, si elles devaient y être autre chose que des objets d’analyse comme les autres, les anciennes notions matricielles de commencement, de genèse, d’origines. Comme le souligne Patrick Boucheron lui-même dans l’introduction, il a été délibérément choisi de commencer cette fresque chronologique par des traces humaines jugées comme ne pouvant a priori appuyer aucun discours national identitaire9. Si cet ouvrage constitue donc largement une réponse aux tenants d’un récit national, il produit une sorte de contre-récit axé sur le refus de l’origine qui le fait justement entrer dans un terrain qui n’est plus choisi par des historiens. A l’opposé des récits déterminés par un commencement absolu, l’HMF constitue une tentative d’histoire décentrée qui incite à se représenter l’histoire bretonne autrement que dans les termes d’une histoire à la fois périphérique et autochtone qui ont dominé les productions du type « histoire de Bretagne ». L’approche permet de réfléchir à une géohistoire de la Bretagne en prenant pour objet les moments ou les événements producteurs d’espaces, qui apparaîtraient alors comme autant de bifurcations brisant l’approche « tubulaire » et péninsulaire qui est justement celle des histoires indigénistes porteuses d’un récit national breton. Elle invite à s’intéresser aux histoires possibles liées à cet horizon.
La déconstruction de la trame de l’Histoire de France opérée par l’HMF tient au choix de moments qui constituent des brèches dans le grand récit « tubulaire » : des bifurcations dans le temps et dans l’espace qui mettent en évidence d’autres connexions que celle de la continuité imposée par le récit national, d’autres espaces et horizons qui, dans leurs présents respectifs, ne « font pas » la France. Donc, des moments qui dessinent en pointillé des histoires alternatives, qui rappellent que, dans ces mondes qui n’ont pas forcément perduré, d'autres histoires étaient possibles. Il peut s’agir de moments producteurs d’espaces alternatifs à celui de la « Gaule » ou du « royaume » qui ont pu générer autant d’histoires parallèles qui complexifient la trame de la constitution linéaire d’un espace français unitaire ; des moments de changements d’horizons qui suscitent des surgissements d’appropriations rétrospectives du passé, donc créateurs de nouveaux passés, dans le présent d’un espace qui reconfigure sans cesse la genèse dont il se pense l'aboutissement10. Ils rompent ainsi l’évidence de la perception d’un continuum spatio-temporel. Pour autant, la Bretagne n’y est toujours pas perçue comme horizon tourné vers d’autres mondes que ceux représentés, d’un côté, par le récit national, et de l’autre, par l’émergence du Monde proprement dit. C’est en effet l’entrée « 1534 11» qui est la seule à s’intéresser directement aux horizons bretons du royaume. Ce choix présuppose que la Bretagne constituait, avant sa connexion au Monde, un espace-temps défini par son autonomie, une temporalité spécifique dont elle serait brusquement sortie. Il valide donc l’idée d’un continuum indigène que seule l’insertion dans l’espace-Monde, lorsque ce niveau géographique supérieur émerge vers 1500, vient décloisonner. C’est aussi ce que renforce le rapprochement implicite des Bretons et des Iroquois : tout se passe comme si ces mondes cessaient de coïncider avec eux-mêmes, comme s’ils n’avaient pas été – c’est surtout vrai pour la Bretagne, marge extrême occidentale de l’espace-monde eurasiatique – partie prenante de géographies plus englobantes, bien avant 1500. Ce léger déplacement chronologique (qui se substitue à la date indigène traditionnelle de 1532 de la « fin de l’indépendance » ) ne change pas vraiment l’approche de la Bretagne dans les termes d’une histoire résiduelle, et la renforce même du fait de la coïncidence avec l’entrée du Monde12, et dans le Monde. Elle occulte les horizons bretons tournés vers d'autres mondes possibles, évanouis lorsque la principauté, seule face au royaume depuis la disparition de l’Etat bourguignon, lui est incorporée. Par-là, c’est la possibilité même de la Bretagne comme lieu d’histoires qui n’est pas envisagée.
Un bout du monde coïncidant avec une histoire indigène ? Une approche latérale permettrait de se représenter autrement l’histoire d’une périphérie qui semble donc toujours coincée entre le déploiement de deux récits. Elle y participerait de mondes alternatifs au récit national « tubulaire », en tant qu'espace relié à des horizons qui l'éloignent du continuum spatio-temporel qu’il a imposé, procédant de configurations d’où auraient pu émerger d’autres histoires que celle que l’Histoire de France a naturalisée. Elle pourrait donc y être davantage perçue comme un horizon d'histoire. Le choix de 1534 comme moment d’entrée de la Bretagne dans une histoire mondiale renforce la « péninsularisation » d’une histoire qui semble se dérouler dans un cul-de-sac en attente, au bord extrême de l’Ancien Monde, de son insertion dans une histoire globale ou connectée - en attende de mondes. La rupture entre deux époques homogènes de part et d’autre de cette coupure est accentuée : un temps de participation à l’histoire du royaume succède au temps de l’indépendance, ce qui occulte le rôle des contacts anciens. Le contraste est saisissant avec les autres principautés territoriales, dont les géographies mouvantes et les histoires possibles qu’elles recèlent sont bien mises en évidence : c’est le cas de l’Aquitaine, de la Normandie, du Toulousain, de l’Anjou13. L’histoire bretonne demeurerait jusque-là non advenue, car non inscrite dans une dynamique productrice de mondes, impensée dans ses potentialités.
La Bretagne représente la seule entité territoriale (ou perçue comme telle) qui subsiste parallèlement au royaume durant la totalité du millénaire médiéval. La tentation y est donc forte de produire un récit conférant une unité interne à la trame d’une « Histoire de Bretagne ». Les dates-clés de ce genre d'histoire-mémoire imposent la lecture rétrospective d’une histoire indigène, selon une approche qui s’inscrit en creux dans le cadre de l’Histoire de France orientée par la réalisation d’une unité inscrite dès les origines gauloises mais non encore advenue14. Symétriquement, l’issue de l’histoire bretonne est, elle, orientée par la menace constante qui pèse sur son indépendance, la focalisation sur les événements associés aux dates de 1491 ou de1532 l’enfermant dans l’espace péninsulaire et occultant d’autres « 1532 », c’est-à-dire des épisodes emblématiques de l’insertion dans une logique continentale. Dans les deux cas, cette histoire se déroule en contexte indigène, dans un tunnel qui la tient à distance des mondes latéraux dont la Bretagne était partie prenante (parmi lesquels le monde franc)15. Elle n’y est qu’un espace résiduel sans histoire propre, occupé par un récit dont le moteur est la « résistance » des derniers Celtes, qui semblent habiter leur propre temporalité spatialement décalée, à l’intégration au royaume. La valorisation de la défaite vénète (56 avant notre ère) comme épisode inaugural possible de l’histoire indigène est révélateur de ce point de vue. On est ainsi persuadé dans les histoires de Bretagne que les logiques de reproduction qui « font » la Bretagne l’emportent sur les logiques de transformations qui font que l’objet social considéré n’est pas invariant d’une époque à une autre. L’approche « péninsulaire » du récit indigène n’avait donc rien d’évident : sa continuité périphérique procède de celle du récit national. Tant que cet espace breton reste un confin16 du système-Monde, il participe en effet plutôt d’une temporalité propre, éloignée de celle des autres composantes de la Chrétienté en formation. Mais si c’est probablement le cas au cours de la période 400-800, née du fractionnement du monde romain, la péninsule n’en est pas moins simultanément tournée vers le monde mérovingien et les îles Britanniques, comme le montre la persistance des « usages scottiques » des monastères, pointés du doigt lors de la visite de l’Empereur en Bretagne en 81817. Les sorties hors de ce récit opérées par l’HMF invitent alors à montrer à travers quelles bifurcations on passe d’une configuration où la Bretagne pouvait être un monde possible ayant ses propres horizons et participant d’autres mondes, à une autre où c’est finalement l’évidence de sa nature d’espace résiduel, de débris du monde celtique qui s’est imposée dans l’histoire-mémoire – et peu importe que le terme de cette histoire indigène soit placé en -56, 913 ou 1532. Certains moments continuent en effet à alimenter la perception d’une Bretagne au « bout du monde », et révèlent comment s’est mise en place celle d’une histoire autochtone périphérique peu à peu réduite.
Déconstruire Alésia pour reconstruire le tournant de la défaite vénète Alors que l’entrée « 52 avant J.-C. »18 montre comment s’est imposé au XIXe siècle le fondement autochtone du récit national français, l’événement équivalent pour l’espace de la future Bretagne, qui constitua un tournant, est oublié : la défaite armoricaine de -56 avant notre ère. Celle-ci effaça les possibles contenus dans les réseaux vénètes, toujours occultés par « 600 avant J.-C. »19 et « 52 avant J.-C. ». En imposant, dans le récit national, l’image d’une Gaule pré-romaine, ces deux moments biaisaient une approche de la façade atlantique comme espace dépourvu de dynamique. 56 avant notre ère représente, dans le récit indigène breton, un moment plus ambigu, à la fois équivalent et inversé de « 52 avant J.-C. ». L’événement racontait la fin d’une autre histoire que celle que le récit national voulut voir à travers Alésia20. Une histoire s’inscrivant en partie dans de larges horizons, ceux de l’histoire alternative atlantique des Vénètes, soit les possibles liés à un espace distinct de la péninsule armoricaine, de l’Armorique césarienne et de la Gaule pré-romaine. Ce n’est plus « la Gaule » que l’on imagine derrière elle, mais un espace réticulaire dont la fermeture impose la perception d’une histoire en cul de sac et obture la possibilité d’une géographie plus maritime. Par-là, ce moment, tel qu’annexé par les histoires de Bretagne, « autochtonise » la perception de l’histoire bretonne – de même qu’Alésia impose l’idée d’un bloc de passé indigène. Là réside le tournant géohistorique, non pas en ce que cette défaite mettrait fin à l’indépendance de l’ « Armorique ». Il contient donc un énorme malentendu : il fonde et déconstruit simultanément la possibilité d’une histoire indigène, puisque le moment de l’intégration par Rome (qui voit la réorganisation du territoire en cités, l’aménagement d’axes de communication) est pris pour celui de la singularisation, manifestée par cet échec de la résistance armoricaine. Le schéma historiographique « épanouissement par la mer VS déclin par la terre »21, qui traduit bien cette ambiguïté, revient à naturaliser une Bretagne celtique opposée à une Bretagne romane sous influence. Si elle fut paradoxalement choisie comme moment inaugural de l’Histoire de Bretagne, c’est qu’elle facilitait l’identification de la péninsule armoricaine à la future Bretagne (et inversement) et offrait la perception d’un début – enfermé dans le cadre autochtone – d’histoire narrative (il s’agit du premier « événement »). Ainsi, alors qu’ « Alésia » dans le récit national mettait fin à une histoire purement indigène, la destruction de la flotte vénète dans le récit breton du même genre l’ouvrait. Dans les deux cas, ces moments narratifs dessinent l’horizon d’un temps des origines saturant l’ensemble du passé et annexant en un seul bloc l’histoire à venir.
C’est la même approche que l’on retrouve à l’entrée « 1534 », où s’opère la jonction entre la fin du passé indigène et l’ouverture au Monde, reproduisant à l’échelle de la Bretagne un « 52 avant J.-C. » non déconstruit. Le but de cette entrée est de relativiser la notion de « grandes découvertes », le passage de l’inconnu vers le connu, puisque Cartier au contraire ne « découvre » rien. Y. Lignereux souligne ainsi que c’est bien l’absence de rencontre véritable avec les Amérindiens qui caractérise ce moment. Les « terres neuves » de Cartier sont en effet emplies de ce qu’on espère y trouver. Elles sont dédoublées par la production d’un récit qui tient lieu d’espace imaginaire – celui du royaume de Saguenay, mirage dont la réalité est rapportée par Cartier à son retour en France. Les horizons américains semblent alors, d’un même mouvement, aussi bien happer les horizons bretons de l’imaginaire poétique médiéval, que recouvrir les possibles liés à l’histoire bretonne22. Celle-ci semble désormais sans objet, ce qui alimente sa lecture rétrospective en termes d’espace résiduel. Car 1532 sous-entend, dans le récit national breton, une levée de rideau de fer qui permet à deux histoires distinctes de confluer. Y. Lignereux ne fait pas autre chose en racontant l’histoire d’un navigateur malouin qui dilate les horizons du royaume, mais la Bretagne n’y est plus qu’un décor, non présentée dans sa géographie particulière. Elle semble devenir transparente car annexée, oubliée comme lieu d’histoire. Si elle paraît perçue comme naturellement orientée vers les horizons du Monde, on imagine en arrière-plan une histoire comprimée en attente du franchissement de l’Atlantique. Cette levée de rideau légitime le récit indigéniste car elle occulte les connexions plus anciennes. Une fois celui-ci levé, les Bretons, entrant soudain dans le synchronisme de la temporalité commune du système-Monde, font participer le royaume à la mondialisation. Mais la Bretagne n’est pas non plus pensée comme l'espace d'une histoire faite aussi de dynamiques endogènes, plutôt comme le simple prolongement de celui-ci, regardée à travers les possibilités d’arrimage à l’espace atlantique. Elle reste donc un bord du Monde. Dans ce basculement sans transition de l’Italie à l’Amérique – 1534 suit « 149423 » –, la projection imaginaire impériale occulte les potentialités liées à l’espace breton. Bretons et Iroquois semblent presque, ainsi, simultanément « conquis » et découverts24, transparents sous le regard du récit national. Par la réplique de la croix qui rappelle la conquête royale sur chaque rivage de l’Atlantique, image qui ouvre le récit de Y. Lignereux, Bretagne et Amérique deviennent des espaces sans histoire sur lesquels se surimpose celle du royaume, et sont comme inscrites dans des histoires en attente de Monde. Pourtant, l’auteur suggère discrètement que l’espace breton qui est alors annexé serait bien celui d’une société, donc un des « mondes » de l’Ancien Monde qui participait déjà à la mise en connexion globale des sociétés. Il exprime ainsi l’idée mais sans l’expliciter, selon laquelle la Bretagne, riche sans doute de son ouverture maritime, tiendrait lieu d’Indes pour le royaume25. Le manque de profondeur spatiale de la péninsule est, toutefois, souvent trop important pour permettre à des productions d’espaces « bretons » de s’imposer durablement comme mondes entendus comme espaces autonomes (« la Bretagne », des saints fondateurs à 1532). La perception et la constitution rétrospective de cette histoire indigène peuvent d’ailleurs procéder de la construction du récit national français. L’Empire carolingien a, par exemple besoin des Bretons pour exister : « Toute la province des Bretons passa sous le joug des Francs » en 799, disent les Annales royales carolingiennes, qui créent ainsi les Bretons comme marge rebelle pour imposer l’idée d’Empire26. La perception d’un espace breton se construit à travers ce conflit, il en reçoit son unité et son identité, facilement projetées ensuite sur les périodes antérieure, naturalisant la Bretagne comme entité régionale constituée. Dans la même logique, l’expansion du royaume breton vers les régions romanes après 845 est souvent perçue dans l’Histoire de Bretagne comme un avatar de 1491/1532, c’est-à-dire la fermeture d’un temps des possibles, ici liée au déclin du breton chez les élites. Or, « l’indifférence langagière du temps en politique » exposée par M. Banniard permet de relativiser cette coupure, d’ailleurs parfois déplacée après l’effondrement de ce même royaume lors des incursions vikings27. L’historiographie du récit national breton ne fait pas autre chose que de présupposer l’idée d’un programme qui ne peut plus être rempli28, de rétroprojeter une unité indigène sur la partie « celtique », comme si la Britannia disparaissait dans l’horizon de la Romania, et comme si contacts et liaisons plus anciens n’avaient pas tout autant « fait » cet espace, avant même la rupture du Xe siècle. Comme le Toulousain en 1159, la Bretagne connaît un « tournant silencieux »29 entre 1201 et 1213 qui contribue à l’identifier comme un espace auquel une cohérence et une intégrité sont prêtées. L’assassinat du jeune duc Arthur Ier a ancré la perception, nouvelle, de la Bretagne comme principauté territoriale à part entière. Le moment est celui où elle se détache du monde plantagenêt, pour glisser vers l'espace capétien30. L'alliance avec Philippe Auguste, aussi bien que le renforcement de l’unité de la principauté par les Plantagenêts, ont longtemps été occultés par le rôle maléfique attribué à Jean sans Terre31. L’assassinat est pourtant un événement autant « breton » que « français » car il permet le démantèlement partiel de l’Empire dont Arthur était l’héritier présomptif. Ce changement de géographie porte en lui deux potentialités. Si la Bretagne peut dès lors exister comme principauté indépendante de la France et de l’Angleterre pour la première fois depuis longtemps (ce qui ouvrait une histoire plus autonome32, et de là la possibilité d'une production de mémoire rendant compte de la perception d'un passé indigène), elle était plus que jamais territorialisée dans l'espace du royaume, lequel tend à devenir un horizon englobant, créateur d’un niveau géographique supérieur (le regnum Francie) de plus en plus opérant. Le moment s’inscrit dans la « fabrique imaginaire d’identités cellulaires, car territoriales »33. Autrement dit, les représentations produites sur le passé de la principauté et dans la principauté peuvent alors se territorialiser. La principauté bretonne de la période 1200-1500 se constitue alors comme un espace défini à une nouvelle échelle géographique, à travers sa relation au royaume. Cet espace breton change de nature ; il en résulte une production d’origines qui se focalise sur la recherche d’actes fondateurs légitimants (inscrire les Bretons dans le mouvement des migrations troyennes, par exemple). L’espace breton commence à s’essentialiser dans les représentations historiographiques. On commence à rechercher des origines rendant compte de l’existence de cette principauté bretonne. L’affirmation de la Bretagne comme « monde » doté d’une certaine identité – rétroprojetée dans un lointain passé – est donc contemporaine de l’insertion forte dans un niveau géographique supérieur.
Des logiques de divergence peuvent alors s’animer entre les horizons bretons et ceux de l’histoire nationale. Ainsi, la geste de Du Guesclin à l’entrée « 1369 »34 : l’aventure vers l’Espagne qui aboutit à un régicide montre, d'une part, une projection de l’aristocratie bretonne vers des horizons qui sont ceux de la chrétienté, à la fois distincts des horizons « celtiques » et de ceux du royaume. Elle pose, d'autre part, une question aux textes qui compilent l’histoire de Du Guesclin : comment histoire bretonne et histoire du royaume réfléchissent-elles cette trajectoire et révèlent par cela même leur divergence ? Comment le connétable de Charles V mêlé au meurtre d’un prince annonce-t-il Jeanne d’Arc d’un côté, la soumission de l’Etat breton à une dynastie illégitime de l’autre ? En effet, 1364, peu avant, apparaît comme un point de divergence : Cocherel, grâce à un sauveur issu d’une marge dont l’intégration au royaume n’était pas évidente, assure la possibilité d’un continuum aux Valois mais, la même année, Auray tourne la Bretagne vers l’Angleterre, donc vers les horizons d’une histoire différente. Dans le jeu des connexions et des fermetures aux horizons du large, cette histoire est donc loin de se réduire au moment de sortie hors de l’Ancien Monde. L’histoire bretonne pourrait en effet, à la lumière d’une histoire « mondiale » appréhendée en termes d’horizons mouvants, de géographies successives, apparaître davantage comme celle d’une ancienne marge impériale qui put s’autonomiser et participer de constructions géohistoriques décentrées par rapport au pôle francilien. Et donc s’extraire, là aussi, du mythe de la continuité spatio-temporelle, porté par le récit de la résistance d’une principauté périphérique résiduelle rétive à son absorption. Dans celui-ci, les horizons se limitent en effet, comme à travers Alésia, à un horizon indigène sans fin. L’approche latérale permet ainsi de mettre en valeur l’articulation de logiques méridiennes à des logiques continentales, dont la succession ou la combinaison impliquent de sortir de l’impasse indigéniste.
Des configurations géohistoriques révolues autour d’une logique méridienne La projection vers le Monde a donc pour effet d’occulter la temporalité liée à la configuration géohistorique dont l’espace breton était partie prenante, enjambée par l’entrée dans l’océan en « 1534 », tandis que les horizons moins lointains, méridiens, de cet espace sont laissés de côté et avec eux le rôle déjà ancien des marins bretons – notamment des pilotes – le long des côtes occidentales de l’Europe. C’est cette géographie méridienne qui explique leur présence dans l’Atlantique : les flottes bretonnes jouent un rôle central dans le cabotage européen jusque tard dans le XVIIe siècle35. A travers ce rôle s’est indurée une logique de façade maritime dont la Bretagne fut un des « centres ». D’autres moments permettent en effet de raconter des histoires envisageant la Bretagne comme partie prenante voire matrice d’un autre espace d’histoire où elle apparaît plus « centrale », d’où surgissent des histoires, des moments qui ne font donc pas la Bretagne telle qu’on la perçoit à travers le récit péninsulaire. On entrevoit ainsi la possibilité d’une histoire, non pas « de Bretagne », ce qui serait retomber dans l’illusion du continuum, mais d’une histoire des horizons qui, produisant de nouveaux espaces, mettent en évidence les discontinuités liées à ces bifurcations géohistoriques par lesquelles des configurations « font » et « défont » ce que l’on se représente comme l’espace breton. Dans cette perspective, la Bretagne n’est plus seulement envisagée comme un point d’arrivée ultime (celui de de l’expansion néolithique, par exemple) mais aussi comme espace inséré dans des circulations maritimes constituant un espace atlantique36. Le moment « 451 »37 peut ainsi faire l’objet d’une autre lecture, selon laquelle « tout est possible ». Des « Armoricains » mais aussi des Bretons font partie des groupes guerriers auxiliaires susceptibles d’imposer leur autorité en Gaule. Si l’on suit Léon Fleuriot38, la bataille s’inscrit dans une série d’épisodes fondateurs pour l’émergence territoriale d’asabiyat bretonnes qui s’imposent militairement aux cités armoricaines. Un décentrement du récit vers l’Armorique et la Bretagne permet de voir dans l’épisode la genèse et non la fin d’une période. Vers 470, Riothamus rate le Monde en manquant sa jonction avec une armée romaine : cette bifurcation vers un possible a été effacée et est ici occultée. Elle se rouvre indirectement à l’entrée « 511 »40, où M. Coumert met en valeur la production d’un nouvel espace dont l’induration fut lente et ne fut pas acquise par l’événement du baptême (qui dans l’Histoire de France fait surgir un passé « national »), et dont la Bretagne est implicitement vue comme périphérie. Or des espaces bretons nouveaux, même s'ils ne firent pas, eux, l'objet d'une immédiate mise en récit41 et sont, telle l’énigmatique Domnonée, très mal connus, adviennent eux aussi, selon une histoire en partie parallèle à celle des Francs. Des Bretons christianisés et militarisés auraient pu exactement jouer le même rôle auprès des évêques. Ici, comme dans le récit national, les Francs occupent donc tout l’espace disponible et les Bretons sont oubliés comme vecteur d’horizon. D’ailleurs en 719 ce n’est pas le surgissement d’un envahisseur qui est raconté42, mais bien celui d’une histoire alternative qui « domestique »le conquérant islamique et établit une connexion entre des mondes (« espace et époque intermédiaires », dit F.-X. Fauvelle43). L’idée conjointe de ce moment, celle d’un espace-temps oublié parce qu’avalé par le récit national, de brèche dans le continuum spatio-temporel, peut caractériser aussi le « moment breton » au nord de la Loire : il manquerait l’équivalent d’un « 719 » breton si la documentation le permettait.
D’autres récits du passé pouvaient et ont émergé, décalés par rapport au récit tubulaire, même s’ils ne se sont pas imposés. Le moment le plus emblématique de l’émergence d’un espace décentré par rapport à l’espace national-capétien apparaît à l’entrée « 1066 »44. Ce moment permet la production d’un espace trans-Manche tourné vers la Grande-Bretagne, dans lequel la Bretagne joue un rôle bien plus central qu’à l’échelle de l’Histoire de France, en constituant une composante à part entière. En effet, cette bifurcation créatrice d’espace anglo-normand fait surgir un horizon historiographique breton, plus précisément un passé dont la cohésion est fournie par une matière considérée comme « bretonne » par les contemporains.
Des moments de surgissement d’autres passés bretons Le surgissement d’un « passé absolu » sur le mode de la révélation, à Lascaux en 1940, permet de réfléchir aux moments où émergent des passés renvoyant au temps des origines. Lascaux rappelle en contrepoint la disparition de la Bretagne comme « passé originel » dans l'Histoire de France ; le passé « celtique » qu’il soit confondu avec le temps des mégalithes ou celui de la Gaule indépendante, trouve ici un substitut comme horizon opérant. Ce moment fait écho à d’autres qui permirent le surgissement d’un nouvel horizon de passé au sein duquel ce que l’on se représentait comme le passé « breton » joua un rôle matriciel. Cette potentialité bretonne a pu s’actualiser, dans le monde ouvert en « 1066 », grâce à la bifurcation évoquée à l’entrée « 1137 »45, où F. Madeline fait l’histoire d’une configuration non advenue. C’est en effet un autre « nouvel espace politique»46 qui advient à partir de 1154, lequel favorise le surgissement d’un passé où la France, au lieu d’intégrer l’Aquitaine, est finalement en partie intégrée à l’ensemble arthurien. « 1137 » aurait donc pu faire advenir un autre passé, ce fut finalement 1155 avec le surgissement, en français, du passé arthurien. Le Roman de Brut, présenté à la cour de Londres, incorpore l’espace du royaume à la fois dans le récit (par la conquête de la France par Arthur), dans le présent (celui des domaines plantagenêts aux fondations prétendument arthuriennes ) et par le récit (la réception des textes de la Matière de Bretagne recouvre la moitié nord du royaume). « 1066 » permet ainsi à terme le surgissement d’un nouvel horizon de passé – que s’attribue l’Empire plantagenêt – dont le récit est particulièrement englobant. La production d’un monde normand, outre la centralité plus grande qu’elle confère à la façade atlantique à partir de 1154, ouvre en effet la voie à la possibilité d'une mise en récit nouvelle. L’histoire arthurienne procède de la production d’un passé contemporaine des horizons du nouveau monde anglo-normand, nouvel espace plus que somme d’entités régionales qui s’inventa ainsi un passé fondateur et universalisable. F. Mazel souligne d’ailleurs que les Normands et leurs alliés sont identifiés et s’identifient comme « Francs », ce qui permet de rappeler que les Bretons ne se sont probablement singularisés au sein de ce groupe qu’après coup. Geoffroy de Monmouth forge un passé collectif breton insulaire dont les héritiers sont bien les « Francs » du monde plantagenêt. Ce récit, qui a stupéfié les contemporains, constitue lui aussi le surgissement, la révélation au XIIe siècle d’un « passé absolu ». Il situait une origine dans un temps et un espace disparus, auxquels seul l’empire anglo-normand pouvait véritablement se rattacher. Le royaume arthurien refonde en effet localement, à l’extrême Occident, la possibilité alternative d’une histoire chrétienne à dimension universelle (car elle avait elle aussi commencé à Troie).
De même, « 1534 » annonce indirectement l’émergence du fantasme des origines celtiques de la France. L’approche liant sous un même regard Bretons et Iroquois rend en effet possible, à terme, l’invention d’un passé celtique : ils sont, chacun à leur façon, au plus proche des origines. Comme le souligne Y. Lignereux, Jacques Cartier fait surgir un horizon et un passé lointain : ceux du royaume de Saguenay. Les récits qui l’entourent fournissent une continuité implicite Bretons-Iroquois-Celtes : ils ne montrent pas de rupture absolue avec le « Moyen Âge » dans ce que vient y chercher l’Europe, soit un espace sur lequel la question des origines est projetée, ou bien dont l’investissement s’inscrit dans la continuité impériale vers la croisade, donc la rédemption – soit le retour à l’origine édénique. Le surgissement de Saguenay ne constitue en effet qu’un avatar du passé projeté sur un espace amérindien pensé comme originaire. Son « invention » n’a-t-elle pu comporter un effet retour vers les Celtes comme incarnation d’un passé originel ? Eux aussi furent considérés comme des reliques des bords du monde. Ce royaume existe en effet à travers le récit d’un espace clos et situé de l’autre côté du monde, topographiquement et chronologiquement disjoint du royaume, mais prêt à le rejoindre. Il porte donc passé et futur en lui. L’idée celtomane put, plus tard, s’en faire l’écho, en voyant dans les Bretons des Gaulois à peine transformés, et faire surgir un nouvel horizon de passé, national cette fois : l’Académie celtique impose dès 1807 l’idée d’un passé gaulois qui affleure dans chaque hameau. L’horizon du passé « originel » recouvrit ainsi la rencontre avec les Iroquois, et se déplaça pour « revenir » en Bretagne à un moment où celle-ci ne pouvait plus être perçue autrement que comme le résidu prestigieux d’un passé celtique tout aussi imaginaire. Ernest Renan (comme il est rappelé à l’entrée « 1882 » ) vit ainsi les Bretons comme une « race celtique » survivante – selon les nouveaux termes des horizons du passé qui marquent le XIXe siècle –, fragment de monde autochtone qui subsiste au bord de l’Océan . La Bretagne se retrouve alors, au début du XIXe siècle, investie par la quête des origines, perçue comme lieu où peuvent s’atteindre, mieux qu’ailleurs, celles de la nation50. Il est vraisemblable que le discrédit qui pèse aujourd’hui sur ces questions ait massivement contribué à faire basculer l’histoire bretonne dans l’impensable. Cet horizon celtique, loin de donner lieu à l’élaboration d’une histoire décentrée, fut progressivement abandonné aux seules histoires de Bretagne. Il ne se donna pas sur le mode de la révélation qui fait événement et rend possible la perception d’ « origines » absolues et échappant à la controverse tant elles se perdent dans la nuit des temps, tel le passé qui surgit de nulle part à Lascaux.
Une approche géohistoriquepeut donc montrer une Bretagne tantôt faite comme périphérie plus ou moins autonome, tantôt défaite comme monde, avant qu’une nouvelle configuration ne produise un autre espace « breton ». Ces alternances de configurations géohistoriques imposent tantôt une histoire en cul-de-sac (les histoires indigénistes), tantôt une histoire tournée vers de larges horizons (des histoires alternatives où la Bretagne est davantage « centrée »). Ces basculements, apparitions et disparitions d’horizons, brisent la perspective de l’histoire autochtone et peuvent peut-être expliquer que celle-ci ne s’impose que tardivement dans les productions de passé en Bretagne : la construction d’un récit qui rendrait compte de la perception de ce continuum breton n’émerge probablement pas, au plus tôt, avant le XIIe siècle50. Puisqu’aucun « espace breton » immuable n’est demeuré un domaine de validité opérant sur deux millénaires autrement que rétrospectivement, la question de son commencement, de ses « origines » doit donc être reposée à chaque inflexion géohistorique. En -56, 409, 845 ou 1203, on observe des événements à la fois créateurs et dislocateurs de mondes, imposant des changements d’échelle, qui n’ont été que rétrospectivement annexés par l’historiographie au continuum breton-armoricain. Il est tout à fait frappant que ce parcours chronologique ressemble à la déambulation que donnerait lieu une visite du site de la Vallée des Saints, dépourvue d’un point de départ qui serait plus « premier » qu’un autre. Alors que le « récit » proposé par l’HMF réitère l'absence d'origine, n’accumulant aucune durée, recommençant sans cesse, la Vallée des Saints construit, autour de la production d’un lieu originaire incarnant l’arrivée synchrone des saints bretons, un parcours qui lui-même ne commence ni ne finit nulle part, revenant vers un point-origine lui-même toujours différé d’une statue de saint à l’autre51. A l’épopée indigéniste se substitue une déambulation présentiste52 dans le passé qui tend à postuler l’existence d’un espace breton construit une fois pour toutes, donc toujours résiduel. David FLOCH
1 Voir THIESSE, Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe XVIIIe – XIXe siècle, Paris, Seuil, 1999. 2 GRATALOUP, Christian, « L’histoire du Monde a une géographie (et réciproquement) », Le Débat, n° 54, 2009-2, p. 67-77, notamment p. 74 : « un espace qui a une histoire particulière ». 3 GRATALOUP, Christian, Faut-il penser autrement l’histoire du monde ?, Paris, Armand Colin, 2011, p. 15. 4 Voir CASSARD, Jean-Christophe, « La tradition royale en Bretagne armorique », Revue historique, CCLXXXI/1, 1988, p. 15-45. 5 BLOCH, Marc, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1997, p. 53-57. 6 BORNE, Dominique, Quelle histoire pour la France ?, Paris, Gallimard, 2014, p. 15, 154. 7 CORNETTE, Joël (dir.), La Bretagne. Une aventure mondiale, Paris, Tallandier, 2018, p. 11-12. 8 BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017. Désormais HMF. 9 Il s’agit de « neutraliser la question des origines ». Ibidem, p. 13. 10 Voir par exemple POTIN, Yann, « 1940. Lascaux : l’art mondial révélé par la défaite nationale », in HMF, p. 625-629. 11 LIGNEREUX, Yann, « 1534. Jacques Cartier et les terres neuves », in HMF, p. 262-266. 12 Sur le sens de ce terme, qui désigne un espace procédant d’un certain seuil de connexion des différentes sociétés de la planète, voir GRATALOUP, Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, Paris, Armand Colin, 2009, p. 7, 117 et 185. 13 ROSE, Isabelle, « 910. Le monachisme universel naît entre Jura et Morvan », in HMF, p. 114-117 ; MADELINE, Fanny, « 1137. Le Capétien franchit la Loire », in HMF, p. 141-145 ; MAZEL, Florian, « 1066. Des Normands aux quatre coins du monde », in HMF, p. 128-132 ; DEBAX, Hélène, « 1159. La guerre pour Toulouse », in HMF, p. 151-155 et MAZEL, Florian, « 1282. Mort aux Français ! », in HMF, p. 184-188. 14 BORNE, Dominique, Quelle histoire pour la France…, op. cit., p. 14 : « le recours à l’histoire inscrivait un projet dans une vision téléologique : la France allait quelque part si elle venait de quelque part ». 15 Pour une illustration de la permanence de cette approche péninsulaire, rythmée par les « arrivées » successives, dans une Bretagne donnée dès le Paléolithique, des Celtes, Romains, Bretons, Francs…, voir BODLORE-PENLAEZ, Mikaël et KERVELLA, Divi, Atlas de Bretagne, Spézet, Coop Breizh, 2011. 16 Voir une définition qui pourrait être heuristique pour la Bretagne du haut Moyen Âge dans LEVY, Jacques, Europe. Une géographie, Paris, Hachette, 1998, p. 273 : « limite de type topographique, sans discontinuité, entre deux espaces », « aire-limite, non aisément attribuable à l’un ou l’autre des espaces concernés ». 17 MERDRIGNAC, Bernard, Les Saints bretons entre légende et histoire. Le glaive à deux tranchants ; Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 196-197. 18 POTIN, Yann, « 52 avant J.-C. Alésia ou le sens de la défaite », in HMF, p. 50-54. 19 AZOULAY, Vincent, « 600 avant J.-C. La Grèce avec ou sans la Gaule », in HMF, p. 42-45. 20 Voir CUNLIFFE, Barry, « Britain, the Veneti and Beyond », Oxford Journal of Archaeology, 1, 1982, p. 39-68. 21 Voir GICQUEL, Yvonig, « Du VIème au XVIème siècle : l’espace d’histoire du premier millénaire breton » dans BREKILIEN, Yann (dir.), La Bretagne, Paris, Les Editions d’Organisation, 1982, p. 100-103 ; LE MOYNE DE LA BORDERIE, Arthur, Histoire de Bretagne, J. Plihon et L. Hommay, Rennes, 1905, Tome I , « La péninsule armoricaine à l’Epoque gallo-romaine », carte 1 à la fin du volume. Celle-ci est révélatrice de ce malentendu : la Bretagne existe déjà dans l’Armorique gallo-romaine, où cohabitent les cinq cités et le désert virtuel, représenté par la « grande forêt centrale », décor des futures migrations bretonnes. 22 La coïncidence avec la première publication imprimée (Bâle, 1534) de l’Anglica Historia de Polydore Virgile, qui fait sortir les temps arthuriens de l’historiographie, n’est peut-être que fortuite mais n’en est pas moins frappante. 23 BOUCHERON, Patrick, « 1494. Charles VIII descend en Italie et rate le monde », in HMF,p. 247-251. 24 LIGNEREUX, Yann, in HMF, p. 262 : « Vive le Roi de France Une déclaration qu’il faut entendre résonner singulièrement aussi bien pour les Bretons rattachés au royaume des rois français, depuis 1532 seulement, qu’auprès des deux cent cinquante Amérindiens devant lesquels la croix avait été érigée (…) ; « le monde, pour les Français du débit des années 1530, c’est d’abord le duché de Bretagne qui n’est d’abord que réuni personnellement au roi de France ». 25 Ibidem, p. 264. 26 ISAÏA, Marie-Céline, « 800. Charlemagne, l’Empire et le monde », in HMF, p. 96. 27 BANIARD, Michel, « 842-843. Quand les langues ne faisaient pas les royaumes », in HMF, p. 108. 28 Par exemple : CASSARD, Jean-Christophe, Les Bretons et la mer, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, p. 65 et suivantes. 29 DEBAX, Hélène, « 1159. La guerre… », art. cit., p. 151. 30 Ainsi comme pour les Scandinaves évoqués p. 190-91 par Etienne Hamon, Paris est un « horizon d’attente « pour les clercs bretons du XIIIe siècle, là aussi en raison de l’absence de centre culturel régional « d’envergure ». 31 Cet épisode est ainsi particulièrement mis en relief dans une production emblématique de l’histoire mémoire nationaliste comme celle de CAOUISSIN, Herri, JOBBE-DUVAL, Félix, Istor Breizh Toutouig, Landerneau, Ololé, 1944, s. p. 32 L’écho historiographique de Bouvines ne résonne pas dans l’espace breton : voir DUBY, Georges, 1985 [1973], Le dimanche de Bouvines, Paris, Gallimard, 1985, p. 309. 33 POTIN, Yann, « Saint-Louis naît à Carthage », in HMF, p. 179.. 34 FORONDA, François, « 1369. Une première guerre d’Espagne », in HMF, p. 219-222. 35 Voir NOREL, Philippe, 2012, « Audierne, un port breton dans l’histoire globale », sur le blog « Histoire globale » que cet auteur a fondé. 36 CUNLIFFE, Barry, The Celts. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 18-26. C’est dans un tel espace que se seraient formées les langues celtiques. 37 BOZOKY, Edina, « 451. Quand les Barbares défendent la Gaule romaine », in HMF, p. 81-85. 38 Voir FLEURIOT, Léon, Les origines de la Bretagne, Paris, Payot, 1999, p. 163-178. 39 Voir, pour le sens de ce concept importé de l’histoire impériale islamique, MARTINEZ-GROS, Gabriel, 2014, Brève histoire des empires, Paris, Seuil, p. 18-21. 40 COUMERT, Magali, « 511. Les Francs choisissent Paris pour capitale », in HMF, p. 86-90. 41 Qui aurait ainsi pu imposer un cadre géographique, des annales fondatrices, donc une épaisseur temporelle qui se serait plus facilement imposée à la mémoire. 42 FAUVELLE, François-Xavier, « 719. L’Afrique frappe à la porte du pays des Francs », in HMF, p. 91-94. 43 Ibidem, p. 93. 44 MAZEL, Florian, « 1066. Des Normands aux quatre coins du monde », art. cit. 45 MADELINE, Fanny, « 1137. Le Capétien… », art. cit. 46 Fanny Madeline montre bien ce mouvement de va-et-vient de géographies dont les horizons se dessinent puis disparaissent, évoquant p. 142 l’ « espace couvert par les chartes royales » capétiennes qui se dilate au moment où l’Angleterre connaît la guerre civile. 47 VENAYRE, Sylvain, « 1882. Professer la nation », in HMF, p. 523. 48 RENAN, Ernest, « La Poésie des races celtiques », Revue des Deux Mondes, janvier-mars., 1854, p. 474-475. 49 VENAYRE, Sylvain, Les Origines de la France. Quand les historiens racontaient la nation, Paris, Seuil, 2013, p. 152-162. 50 Voir DE MONMOUTH, Geoffroi (édition et traduction de MATHEY-MAILLE, Laurence), Histoire des rois de Bretagne, Paris, Les Belles-Lettres, 1992. 51 http://www.lavalleedessaints.com/en/ 52 Voir HARTOG, François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
 |